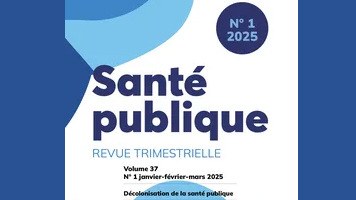Lorsque les vécus d’oppression se propagent des patient.es aux chercheur.es : comment intégrer les données expérientielles à la recherche en santé mondiale ?
Introduction : la question (post)coloniale en santé mondiale
Depuis 2018, plusieurs propositions ont été faites pour aborder les enjeux de (dé)colonisation de la santé mondiale, notamment en ce qui concerne la gouvernance, le financement et les partenariats transnationaux, mais aussi les disparités en matière d’accès et de production de la connaissance scientifique (1-3). Certains ont réagi en proposant des moyens de renforcer les capacités des équipes des pays du Sud global (4), alors que d’autres ont critiqué ces initiatives puisqu’elles ne permettent pas d’aborder les causes profondes des inégalités observées (5). En ce sens, plusieurs affirment que les inégalités persistent parce qu’elles sont indissociables des mécanismes d’oppression en place (6-8). Il est d’ailleurs mis en avant qu’un changement de paradigme de l’économie politique mondiale et des changements structurels à l’échelle internationale sont nécessaires. Certains encouragent les chercheur.es à se dissocier des modèles dominants et hégémoniques de production de la connaissance en adoptant une posture anti-coloniale de désobéissance épistémique (9) et de refus des structures en place puisqu’elles sont porteuses du legs colonial (10).
À une tout autre échelle, quelques propositions ont été faites en ce qui concerne l’importance de la réflexivité dans ce champ. Certain.es ont proposé des typologies permettant de cerner les différents aspects des interventions en santé (11), générant des propositions quant à la manière d’intégrer les pratiques réflexives en équipe (12-13). Pour capter toutes les subtilités du travail réflexif, plusieurs propositions ont été faites pour en distinguer les dimensions éthiques (14), dialogiques (15-16), structurelles (17), instrumentales (18), épistémiques (19) et décoloniales (5). Ces propositions mettent toutes l’accent sur l’importance de dépasser un simple énoncé des caractéristiques de l’identité sociale des chercheur.es pour porter un regard critique sur la manière dont leurs identités sociales influencent la recherche, les processus aussi bien que les résultats.
Ces approches sont orientées vers des spécificités sociales et structurelles de la pratique réflexive afin de capter la complexité du champ d’intervention de la santé mondiale. Elles se penchent néanmoins très peu sur les dimensions plus subjectives et affectives du travail réflexif. Or, la réflexivité réfère à une pratique itérative ancrée dans les savoirs expérientiels et corporels ; et puisque le registre expérientiel est par nature complexe, ambigu, ambivalent, voire inconfortable, il se traduit difficilement en mots, ce qui rend donc la notion de réflexivité difficile à circonscrire (20-21). La réflexivité permet d’identifier les points d’incompréhension et les ajustements requis, elle permet de mener ultérieurement des recherches plus ajustées aux contextes (22-23). Ce processus de va-et-vient impliquant le registre émotionnel engendre « la capacité à penser » et à regarder autrement son objet d’étude et la manière dont nous sommes engagé.es face à celui-ci (24).
En santé mondiale, il est particulièrement pertinent de prendre en considération la dimension affective afin d’appréhender l’influence des rapports (post)coloniaux sur le monde interne et les dynamiques intersubjectives. Les inégalités résultant des structures oppressives (capitalisme, [néo]colonialisme, racisme, sexisme, classisme, sanisme) sur lesquelles s’attarde la santé mondiale ne façonnent pas uniquement les objets d’étude et d’intervention, mais également le cadre relationnel de la recherche. En effet, les partenariats entre les équipes du Nord et du Sud global sont assujettis à des rapports de pouvoir disproportionnés influençant nécessairement la nature des relations s’établissant dans ces cadres. De plus, les répercussions des recherches et des interventions sur les individus, les communautés et les systèmes de santé sont bien réelles, d’où l’importance d’affiner les pratiques réflexives afin de proposer des pistes d’intervention favorisant l’équité en santé et la justice sociale plutôt qu’une reproduction des déséquilibres de pouvoir en place.
En plus des dimensions concrètes et tangibles des inégalités économiques et politiques à l’échelle mondiale et de leurs effets sur la santé des populations, la matrice coloniale du pouvoir (25-27) reproduit de façon insidieuse les systèmes d’exploitation instaurés par les puissances coloniales européennes, puis par les États représentant la modernité (Amérique du Nord). Au-delà des segmentations sociales qu’elle établit et maintient, cette matrice propage une vision du progrès et du développement ancrée dans les valeurs et visions du monde des pays en position de domination à l’échelle mondiale (28), ce qui s’incarne particulièrement dans le champ de la santé mondiale. Ainsi, la matrice coloniale a non seulement des répercussions sociales et politiques significatives se traduisant par des conditions de vie défavorables des groupes opprimés, mais également des effets insidieux sur la manière dont ces groupes envisagent leur participation sociale et leur légitimité (29).
Faisant écho au concept d’injustices épistémiques (30) maintenant largement employé, notamment en santé mondiale, la notion de « colonialité » (25-27) permet de saisir la complexité géopolitique des systèmes de domination, de même que leurs manifestations à une échelle plus intime. Quijano (26) propose le concept de « colonialité du savoir » pour décrire la manière dont le pouvoir colonial et la domination de la vision du monde euro- et américano-centrée écrasent et invisibilisent d’autres univers de sens. Selon Quijano, ultimement, à travers ce prisme, les savoirs dominants provenant des puissances coloniales sont perçus comme foncièrement valides, alors que les savoirs à la marge sont délégitimés, disqualifiés et supprimés.
Dans cette construction hiérarchique de la connaissance, les savoirs sont décontextualisés et déterritorialisés (31-32). Les savoirs scientifiques, occidentaux et modernes sont considérés comme universels, alors que les savoirs subalternes (33) sont considérés comme provenant de contextes socio-culturels spécifiques et n’ayant aucune validité en dehors de ceux-ci. Ainsi, ce courant décolonial engage une réflexion quant à l’importance d’ancrer les savoirs dans un lieu géographique, dans une corporalité/subjectivité ainsi que dans une compréhension politique ; c’est en ce sens que Tlostanova et Mignolo (2009) proposent le concept de savoirs géo-corpo-politiques (34). L’inclusion de ces savoirs permettrait une « ré-existence » (35-36) des personnes marginalisées et opprimées, c’est-à-dire une possibilité d’exprimer leurs préoccupations selon leurs propres points d’ancrage, leurs perspectives et leurs visions du monde.
Pour sortir de la binarité entre les savoirs dominants et « subalternes », et donc de l’hégémonie de la matrice coloniale, il est avancé que les savoirs traditionnellement mis de côté – notamment les savoirs expérientiels, affectifs, coutumiers, vernaculaires – doivent être légitimés et intégrés à un dialogue. Selon cette perspective, l’intégration authentique de ces savoirs permettrait une réelle rencontre interculturelle, puis l’adoption d’une perspective pluriverselle et éventuellement une éthique globale décoloniale (37).
Members and SHERPA Teams

Elise Bourgeois-Guérin
Professor, Département Sciences humaines, Lettres et Communications, Université TÉLUQ