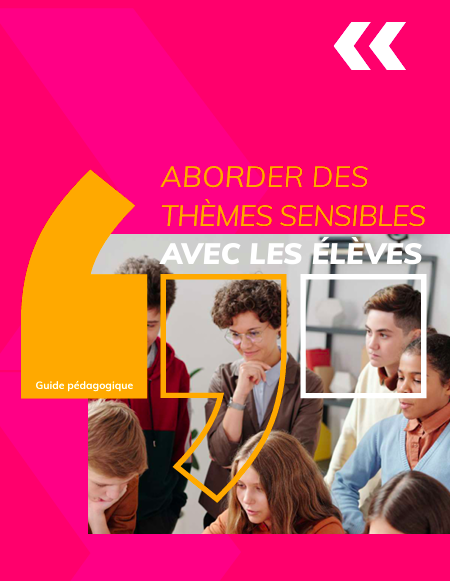
Aborder des thèmes sensibles avec les élèves
Hirsch, S., Audet, G., Gosselin-Gagné, J. et Turcotte, M. (2023)
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2023 | 18 p.
VOIR LA PUBLICATION >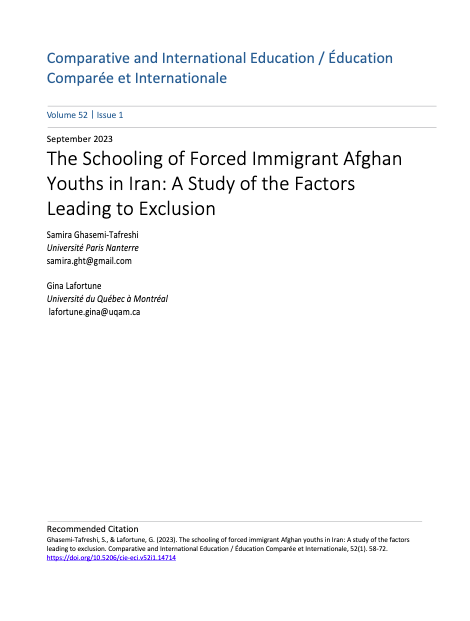
The Schooling of Forced Immigrant Afghan Youths in Iran: A Study of the Factors Leading to Exclusion
Ghasemi-Tafreshi, S., & Lafortune, G. (2023, septembre)
Comparative and International Education / Éducation Comparée et Internationale
Vol. 52/ num. 01 | 16 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Are we training our students to be white saviours in global health?
Banerjee, A. T., Bandara, S., Senga, J., González-Domínguez, N., & Pai, M. (2023, aout)
The Lancet
Vol. 402/Num. 10401 | 2 p.
VOIR LA PUBLICATION >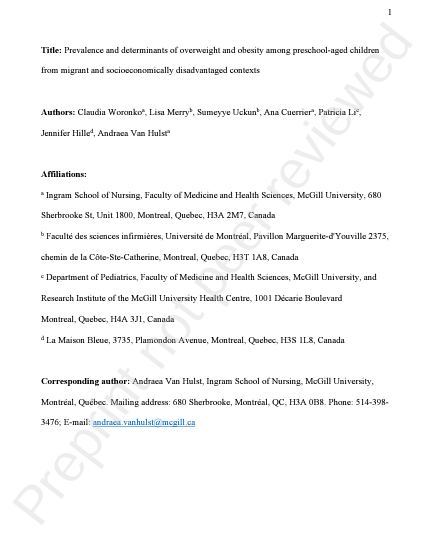
Prevalence and Determinants of Overweight and Obesity Among Preschool-Aged Children from Migrant and Socioeconomically Disadvantaged Contexts
Woronko, C., Merry, L., Uckun, S., Cuerrier, A., Li, P., Hille, J., & Van Hulst, A. (2023, mars)
SSRN
Elsevier | 29 p.
VOIR LA PUBLICATION >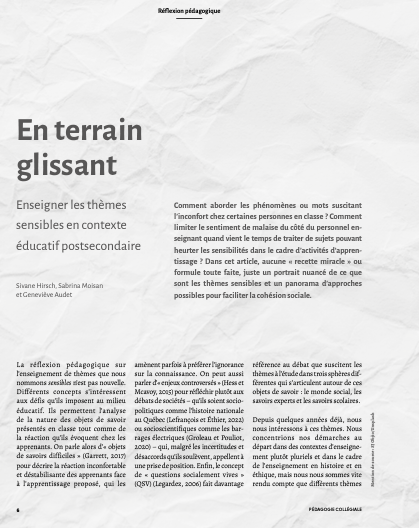
En terrain glissant : enseigner les thèmes sensibles en contexte éducatif postsecondaire
Hirsch, S.; Moisan, S.; Audet, G. (2023, février)
Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC)
Vol. 36/ num. 2 EDUQ.info | 8 p.
VOIR LA PUBLICATION >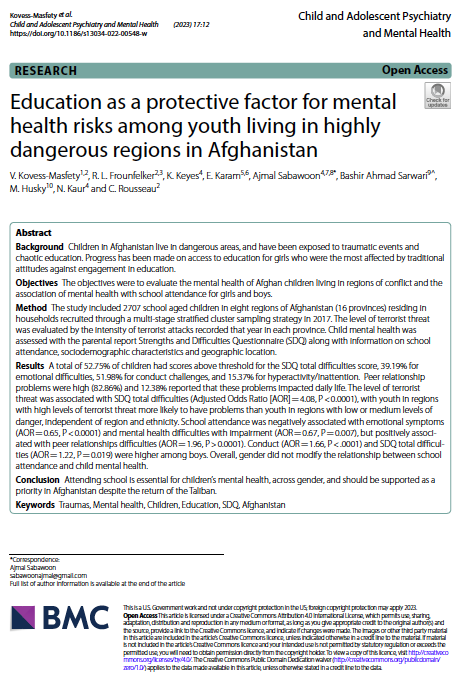
Education as a protective factor for mental health risks among youth living in highly dangerous regions in Afghanistan
Kovess-Masfety, V., Frounfelker, R.L., Keyes, K., Rousseau, C. (2023, janvier)
Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health
Vol.17/ Article number: 12 : Research Open Access | 13 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Integrating Practice Research into Social Work Field Education in Canada
Sheri M. McConnell, Melissa Noble, Jill Hanley, Vanessa Finley-Roy & Julie Drolet (2023, janvier)
Journal of Teaching in Social Work
Vol.43/ Issue 1 | 19 p.
VOIR LA PUBLICATION >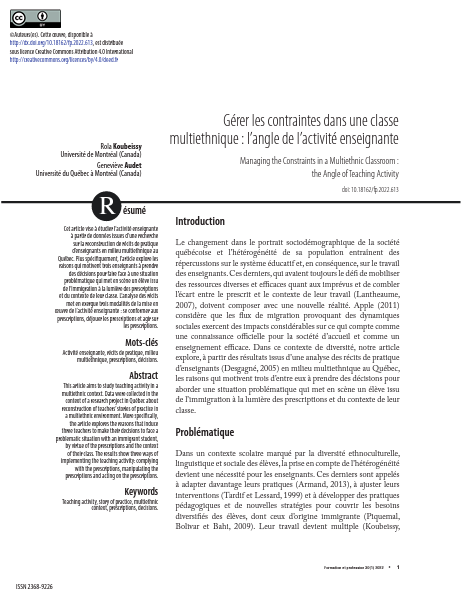
Gérer les contraintes dans une classe multiethnique : l’angle de l’activité enseignante
Koubeissy, R. et Audet, G. (2022)
Formation et profession
Vol. 30/ Issue 1 | 12 p.
VOIR LA PUBLICATION >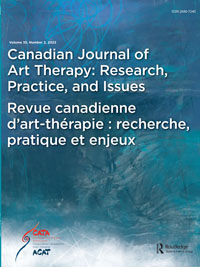
L’enseignement par expérientiels à distance ? Réflexion sur l’impact potentiel de la pandémie de COVID-19 sur le sentiment d’efficacité personnelle des étudiantes en art-thérapie
Beauregard, Caroline, and Lise Pelletier (2022, septembre)
Canadian Journal of Art Therapy
Vol. 35/ Issue 2 | 8 p.
VOIR LA PUBLICATION >
INTÉGRATION ET INCLUSION : interconnexions et oppositions dans deux domaines éducatifs au Québec
Charette, Josée et Corina Borri-Anadon (2022)
Revista Periferia
Vol. 14/ n. 2 Revista Periferia – PPGECC/UERJ - ISSN: 1984-9540
VOIR LA PUBLICATION >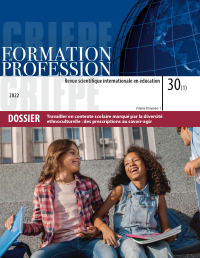
Travailler en contexte scolaire marqué par la diversité ethnoculturelle : des prescriptions au savoir-agir
Koubeissy, R. et Audet, G. (2022)
Formation et profession : revue internationale en éducation
Vol. 30 (1)
VOIR LA PUBLICATION >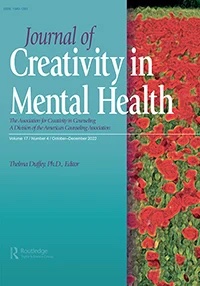
Creating a safe space during classroom-based sandplay workshops for immigrant and refugee preschool children
Beauregard, Caroline, Cécile Rousseau, Maryse Benoit, and Garine Papazian-Zohrabian (2022, mai)
Journal of Creativity in Mental Health
1/17
VOIR LA PUBLICATION >
Quand le thème de la guerre s’invite à l’école. Aide-mémoire pratique pour les intervenant·e·s scolaires
Papazian-Zohrabian, G. et C. Mamprin (2022)
Montréal | 2 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Anti-racist education in social work: an exploration of required undergraduate social work courses in Quebec
Shah, K.; Boatswain-Kyte, A. and E.O.J. Lee (2022, février)
Canadian Social Work Review / Revue canadienne de service social
Vol. 38, number 2 : Erudit | 16 p.
VOIR LA PUBLICATION >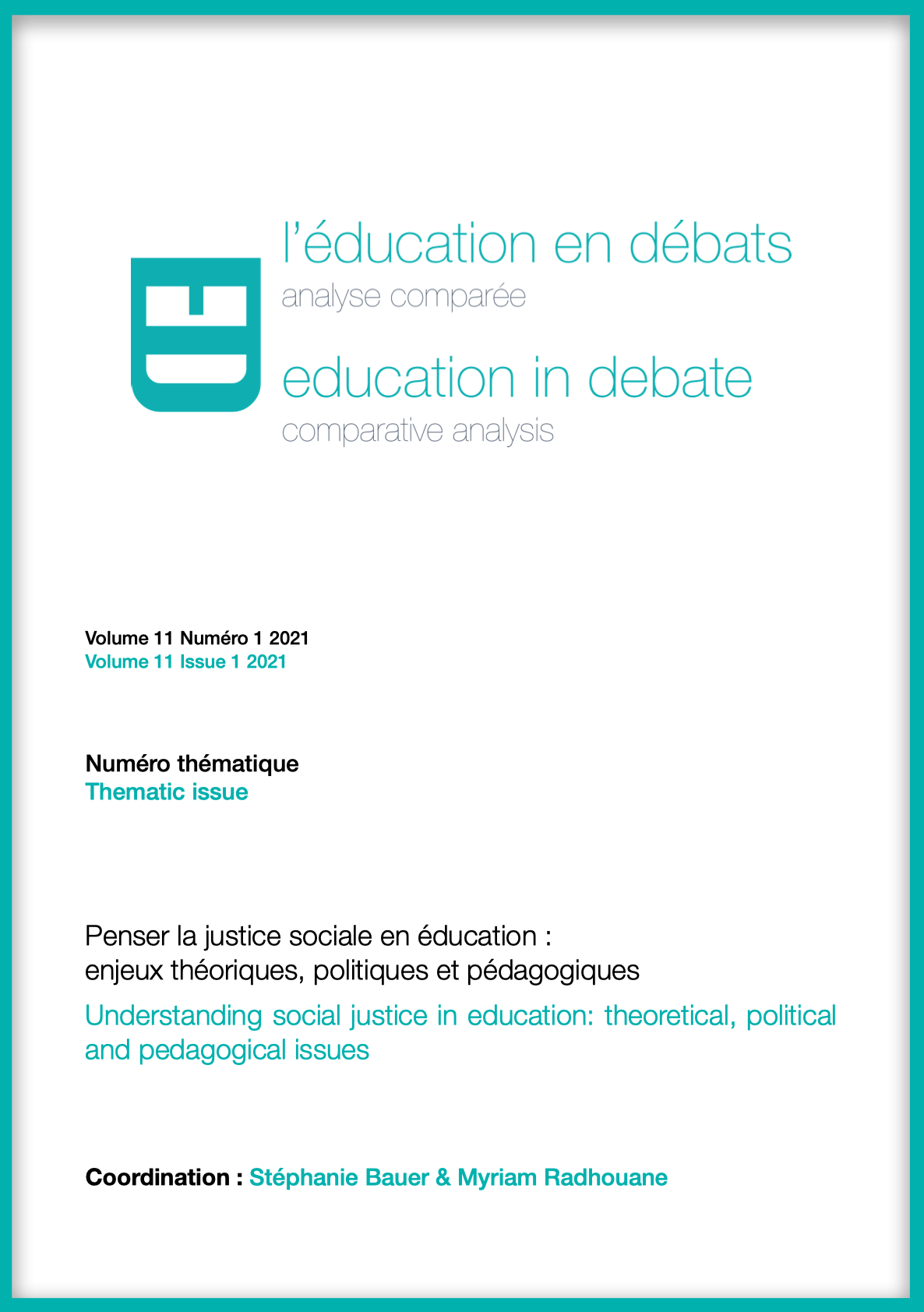
Teachers’ critical reflection: what are the practices for social justice in education?
Koubeissy, R., & Audet, G. (2021)
L’éducation En débats : Analyse comparée
11(1) | p. 60–77.
VOIR LA PUBLICATION >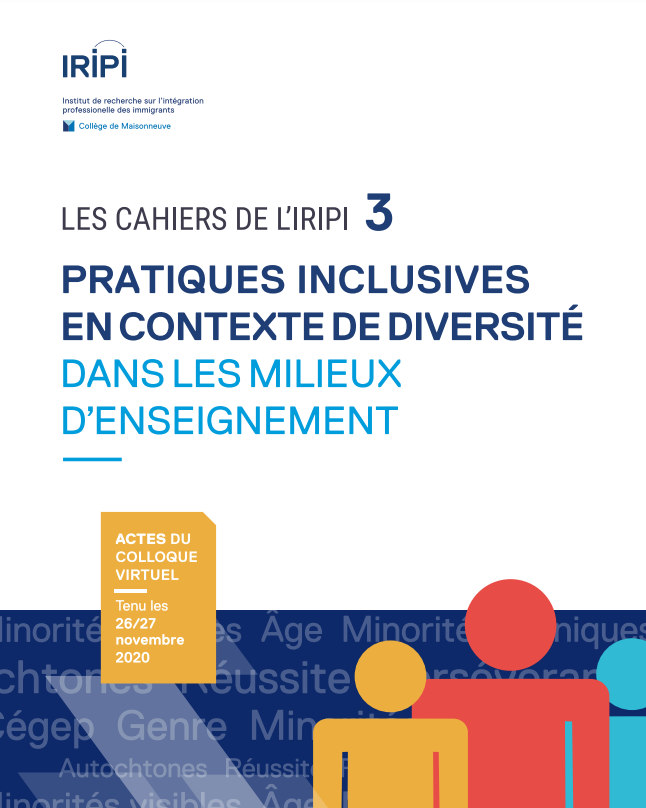
De l’inclusion et de la réussite au collégial : « Au fond, vous voulez savoir ce que ça veut dire être noir.e au cégep? »
Lafortune, G. (2021)
Montréal : IRIPI | p.8-15
VOIR LA PUBLICATION >
Les jeunes réfugiés et les enfants de la guerre à l’école québécoise
Papazian-Zohrabian, G. et C. Mamprin (2021)
La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation : théorie et pratique. 2e édition (Maryse Potvin, Marie-Odile Magnan, Julie Larochelle-Audet et Jean-Luc Ratel dirs.)
Groupe Fides | p.273-290
VOIR LA PUBLICATION >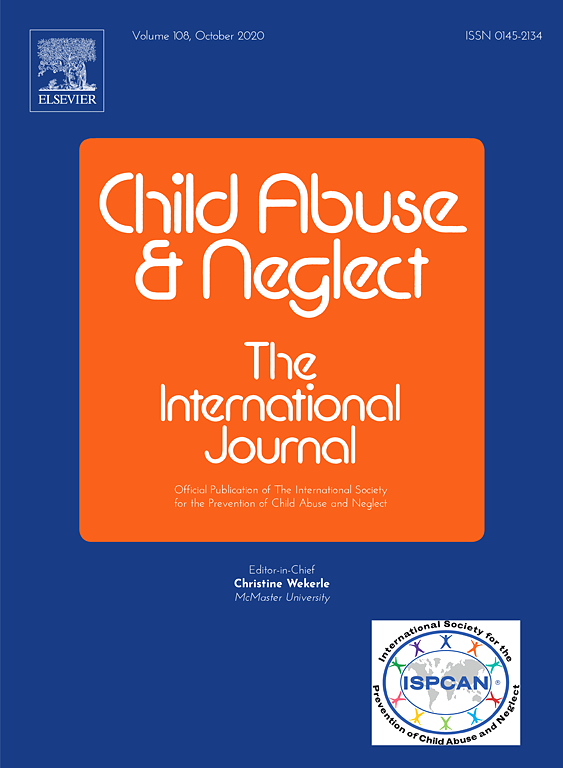
The role of individual-, family-, and school-level resilience in the subjective well-being of children exposed to violence in Namibia
Gentz, S., Zeng, C., Ruiz-Casares, M. (2021)
Child Abuse and Neglect
Child Abuse & Neglect
VOIR LA PUBLICATION >
Édito – L’éducation inclusive en contexte de diversité ethnoculturelle : comprendre les processus d’exclusion pour agir sur le terrain de l’école
Magnan, MO, Gosselin-Gagné, J., Audet, G. and Conus, X. (2021, mars)
Recherches en éducation
44
VOIR LA PUBLICATION >
Regards d’acteurs et d’actrices scolaires quant à l’engagement en faveur d’une culture d’équité dans des écoles secondaires québécoises
Borri-Anadon, C., Audet, G., and Lemaire, Eve (2021, mars)
Recherches en éducation
44
VOIR LA PUBLICATION >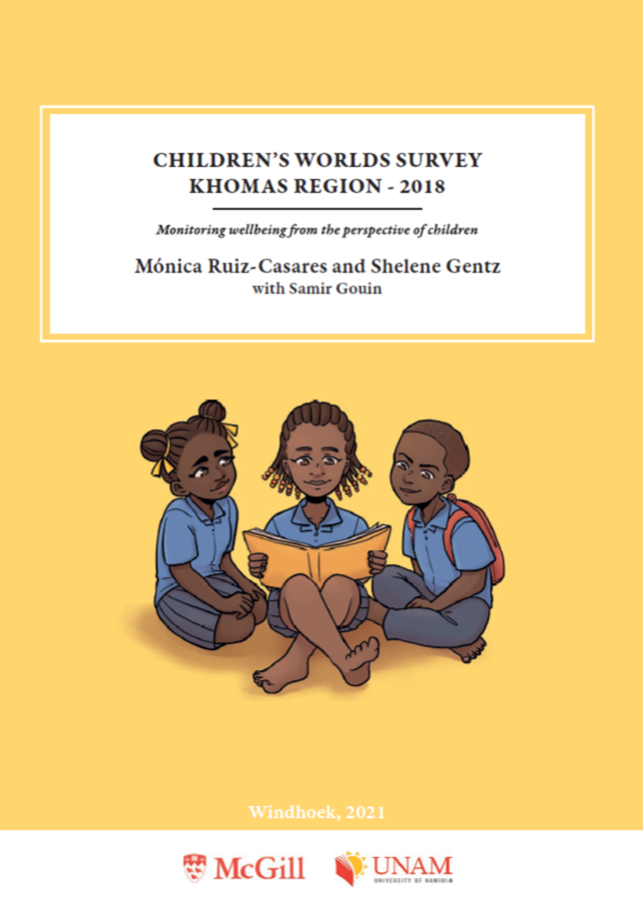
Children’s Worlds Survey Khomas Region – 2018. Monitoring wellbeing from the perspective of children
Ruiz-Casares, M.; Gentz, S.; Gouin, S. (2021)
Namibia: McGill University and University of Namibia | 69 p.
VOIR LA PUBLICATION >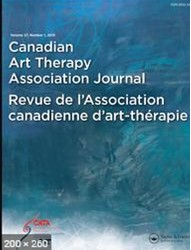
Favoriser la conscience émotionnelle et la restauration du lien social par le dessin : le cas d’enfants immigrants en classe d’accueil
Beauregard, C., Caron, ME., Caldairou-Bessette, P. (2020)
Canadian Journal of Art Therapy
online 15 décembre 2020 | p. 70-79
VOIR LA PUBLICATION >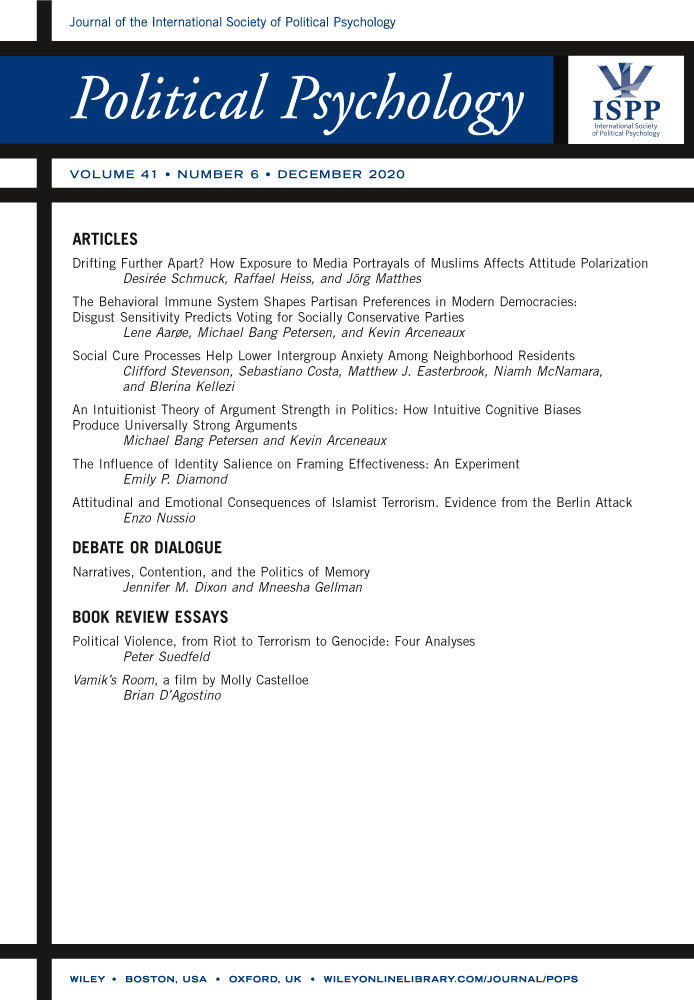
Are there Local Differences in Support for Violent Radicalization? A Study on College Students in the Province of Quebec, Canada
Miconi, D., Calcagnì, A., Mekki‐Berrada, A. et C. Rousseau (2020)
Political Psychology
online 13 décembre 2020
VOIR LA PUBLICATION >
Overcoming “You Can Ask My Mom”: Clinical Arts-Based Perspectives to Include Children Under 12 in Mental Health Research
Caldairou-Bessette, P., Nadeau, L. et C. Mitchell (2020)
International Journal of Qualitative Methods
VOIR LA PUBLICATION >
Comment favoriser la communication thérapeutique avec une population vulnérable ? Des approches et des outils pour les professionnels prenant en charge les mineurs non accompagnés
Gautier, Lara; Spagnolo, Jessica; Quesnel-Vallée, Amélie (2020)
Migrations Société
3(181) | pp. 121-134
VOIR LA PUBLICATION >
Vivere insieme in contesti di polarizzazione sociale: fattori di rischio e di protezione in un campione di giovani studenti canadesi / Vivre ensemble dans des contextes de polarisation sociale: facteurs de risque et de protection chez un échantillon de jeunes étudiants canadiens
Miconi, D., Rousseau, C. (2020)
Educationla Reflexive Practice
1 | pp. 55-73
VOIR LA PUBLICATION >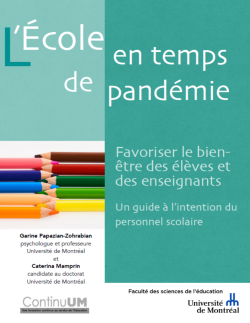
L’école en temps de pandémie : favoriser le bien-être des élèves et des enseignants
Papazian-Zohrabian, Garine et Caterina Mamprin (2020)
Montréal : Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal | 33 p.
VOIR LA PUBLICATION >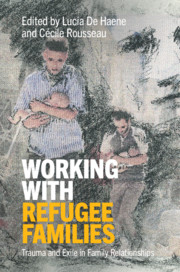
Collaborative Mental Health Care for Refugee Families in a School Context
Papazian-Zohrabian, G., Mamprin, C., Turpin-Samson, A., & Lemire, V. (2020)
Working with Refugee Families: Trauma and Exile in Family Relationships (L. De Haene & C. Rousseau (Dirs.))
Cambridge: Cambridge University Press | pp. 292-308
VOIR LA PUBLICATION >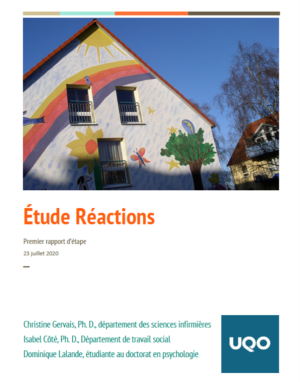
Étude Réactions. Premier rapport d’étape
Gervais, C., Côté, I., Lalande, D. (2020)
Université du Québec en Outaouais | 9 p.
VOIR LA PUBLICATION >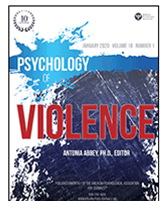
Sympathy for violent radicalization among college students in Quebec (Canada): The protective role of a positive future orientation
Miconi, Diana & Oulhote, Youssef & Hassan, Ghayda & Rousseau, Cécile (2020)
Psychology of Violence
10(3) | 344-354
VOIR LA PUBLICATION >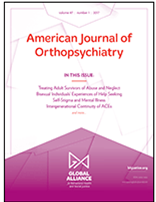
A repeated cross-sectional study of sympathy for violent radicalization in Canadian college students
Rousseau, Cécile; Miconi, Diana; Frounfelker, Rochelle; Hassan, Ghayda; Oulhote, Youssef (2020, janvier)
American Journal of Orthopsychiatry
VOIR LA PUBLICATION >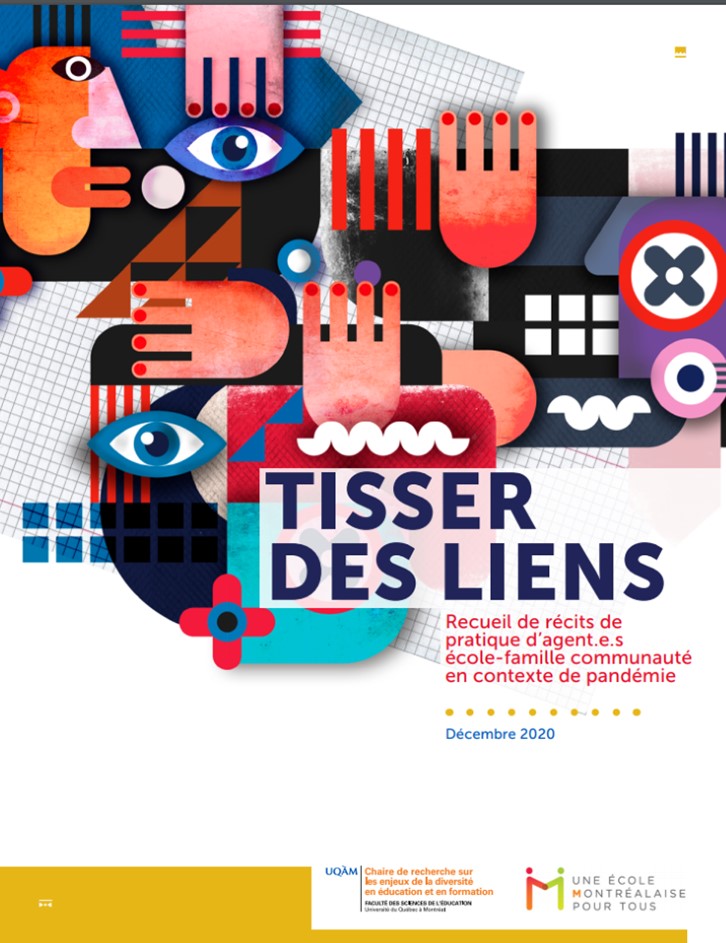
Tisser des liens. Recueil de récits de pratique d’agent.e.s école-famille communauté en contexte de pandémie
Audet, G., Anna, Ghi, Jahir, Jessica, Léanne, Maclé, Majda, Maria, Mima, Nadia , Patsy et Sunita (2020)
Montréal : Chaire de recherche sur les enjeux de la diversité en éducation et en formation | 62 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Mettre des mots
Papazian-Zohrabian, G., Lemire, V et al. (2020)
Cahiers pédagogiques. Les élèves migrants changent l’école
558
VOIR LA PUBLICATION >
Creative expression workshops as Psychological First Aid (PFA) for asylum-seeking children: An exploratory study in temporary shelters in Montreal
de Freitas Girardi, Julia; Miconi, Diana; Lyke, Claire; Rousseau, Cécile (2019, décembre)
Clinical Child Psychology and Psychiatry
12 p.
VOIR LA PUBLICATION >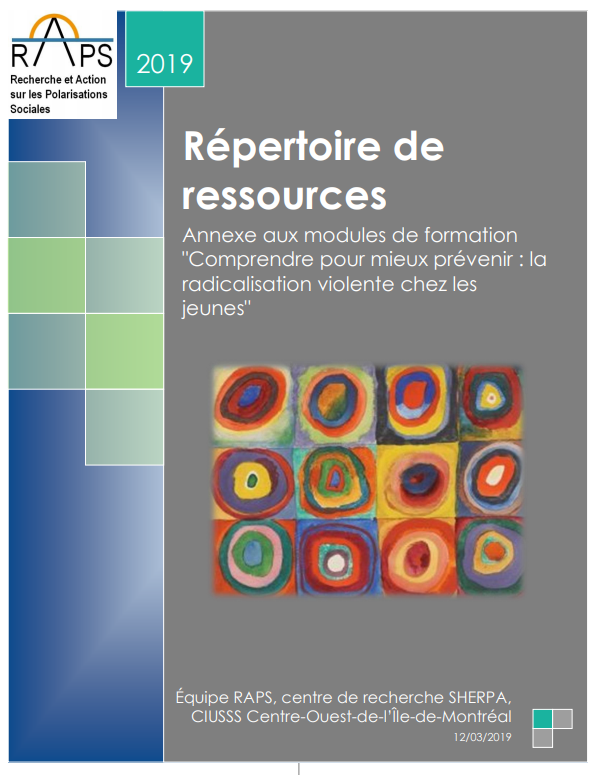
Répertoire de ressources. Annexe aux modules de formation « Comprendre pour mieux prévenir : la radicalisation violente chez les jeunes »
RAPS-SHERPA (2019)
Montréal : RAPS-SHERPA | 79 p.
VOIR LA PUBLICATION >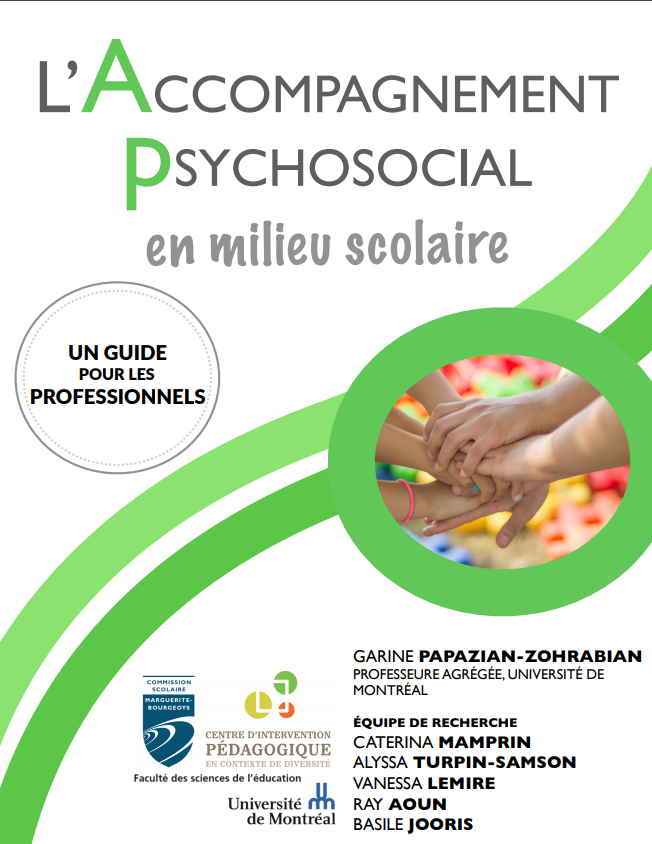
L’accompagnement psychosocial en milieu scolaire. Un guide pour les professionnels
Papazian-Zohrabien, G.; Mamprin, C.; Turpin-Samson, A.; Lemire, V.; Aoun, R. et B. Jooris (2019)
Montréal : Université de Montréal | 36 p.
VOIR LA PUBLICATION >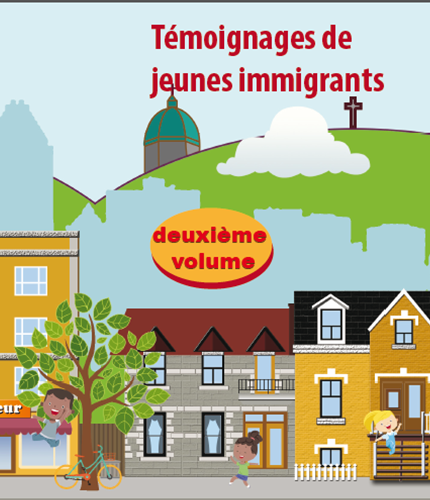
Chez moi… Chez toi… Chez nous… – Deuxième volume – Témoignages de jeunes immigrants
Centre d'Aide aux Familles Latino-Américaines (CAFLA); des élèves de classes d’accueil en francisation de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau (2019)
Centre d'Aide aux Familles Latino-Américaines (CAFLA) | 65 p,
VOIR LA PUBLICATION >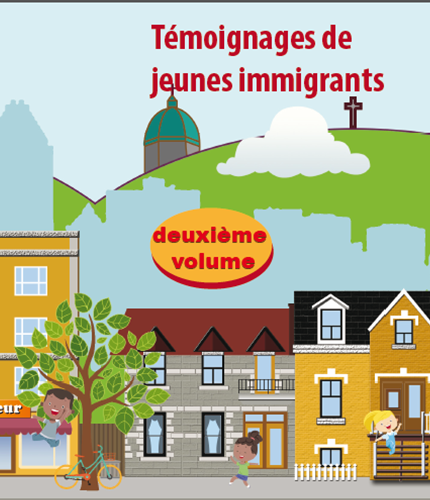
Chez toi. Chez moi. Chez nous. Témoignages de jeunes immigrants. Deuxième volume
Élèves de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau (2019)
Montréal : CAFLA | 65 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Vers une conception théorique multidimensionnelle du climat scolaire interculturel
Archambault, I., McAndrew, M.; Audet, G., Borri-Anadon, C., Hirsch, S., Amiraux, V. et Tardif-Grenier, K. (2018)
Alterstice
8(2) | 117-132
VOIR LA PUBLICATION >
Prendre en compte l’expérience pré-, péri- et post-migratoire des élèves réfugiés afin de favoriser leur accueil et leur expérience socioscolaire
Papazian-Zohrabian, G. Mamprin, C. Lemire, V. et Turpin-Samson, A. (2018)
Alterstice
8(2) | 101-116
VOIR LA PUBLICATION >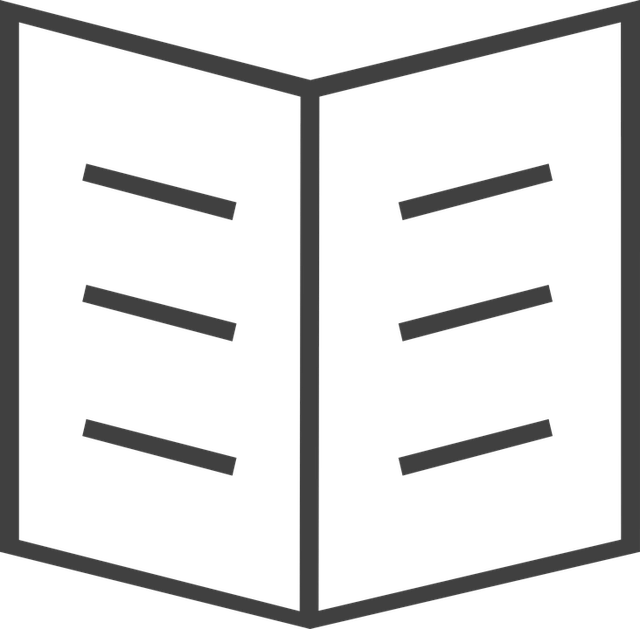
Collective Identity, Social Adversity and College Student Sympathy for Violent Radicalization
Rousseau, C., Oulhote, Y., Lecompte, V., Mekki-Berrada, A., Hassan, G., & El Hage, H. (2019)
Transcultural psychiatry
VOIR LA PUBLICATION >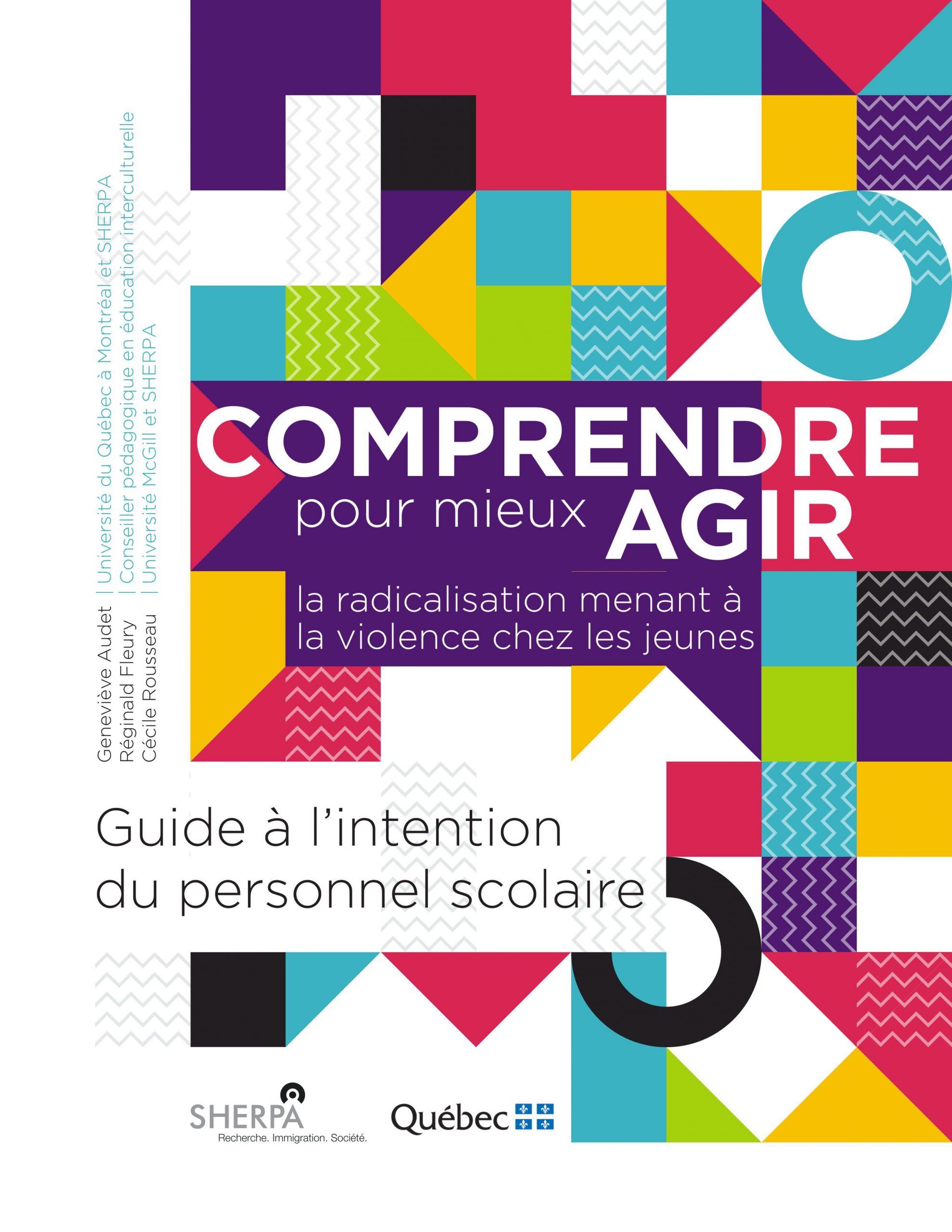
Comprendre pour mieux agir la radicalisation menant à la violence chez les jeunes. Guide à l’itnention du personnel scolaire
Audet, G.; Fleury, R. et C. Rousseau (2019)
Montréal : SHERPA | 17 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Intervention pédagogique et diversité ethnoculturelle: théorisation de récits de pratique d’enseignantes et d’enseignants, et défis de formation
Audet, G. (2018)
Éducation et francophonie, 46(2)
46 | 92-108
VOIR LA PUBLICATION >
Le milieu scolaire face aux défis de l’accueil des élèves réfugiés: quels enjeux pour la gouvernance scolaire et la formation des intervenants
Papazian-Zohrabian, G.; Mamprin, C.; Lemire, V.; Turpin-Samson, A.; Hassan, G.; Rousseau, C.; Aoun, R. (2018)
Éducation et francophonie
46 | 208-229
VOIR LA PUBLICATION >
Le rôle de l’école face à la radicalisation violente: risques et bénéfices d’une approche sécuritaire
Michalon-Brodeur, V.; Bourgeois-Guérin, É.; Cénat, JM.; Rousseau, C (2018)
Éducation et francophonie
46 | 230-248
VOIR LA PUBLICATION >
Parler d’événements violents avec les jeunes
Cécile Rousseau, Tomas Sierra Audrey L-Lachaîne, Anousheh Mashouf, Élise Bourgeois-Guérin et Marie-Ève Paré (2018)
Vidéo | Montréal : SHERPa
VOIR LA PUBLICATION >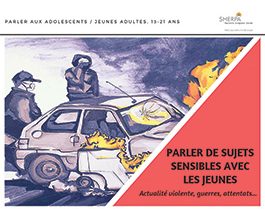
Parler de sujets sensibles avec les jeunes
Cécile Rousseau, Tomas Sierra Audrey L-Lachaîne, Anousheh Mashouf, Élise Bourgeois-Guérin et Marie-Ève Paré (2018)
Montréal : SHERPA | 8 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Parler d’événements violents avec les enfants
Cécile Rousseau, Tomas Sierra Audrey L-Lachaîne, Anousheh Mashouf, Élise Bourgeois-Guérin et Marie-Ève Paré (2018)
Vidéo | Montréal :SHERPA
VOIR LA PUBLICATION >
Parler de sujets sensibles avec les enfants
Cécile Rousseau, Tomas Sierra Audrey L-Lachaîne, Anousheh Mashouf, Élise Bourgeois-Guérin et Marie-Ève Paré (2018)
Montréal : SHERPA | 7 p.
VOIR LA PUBLICATION >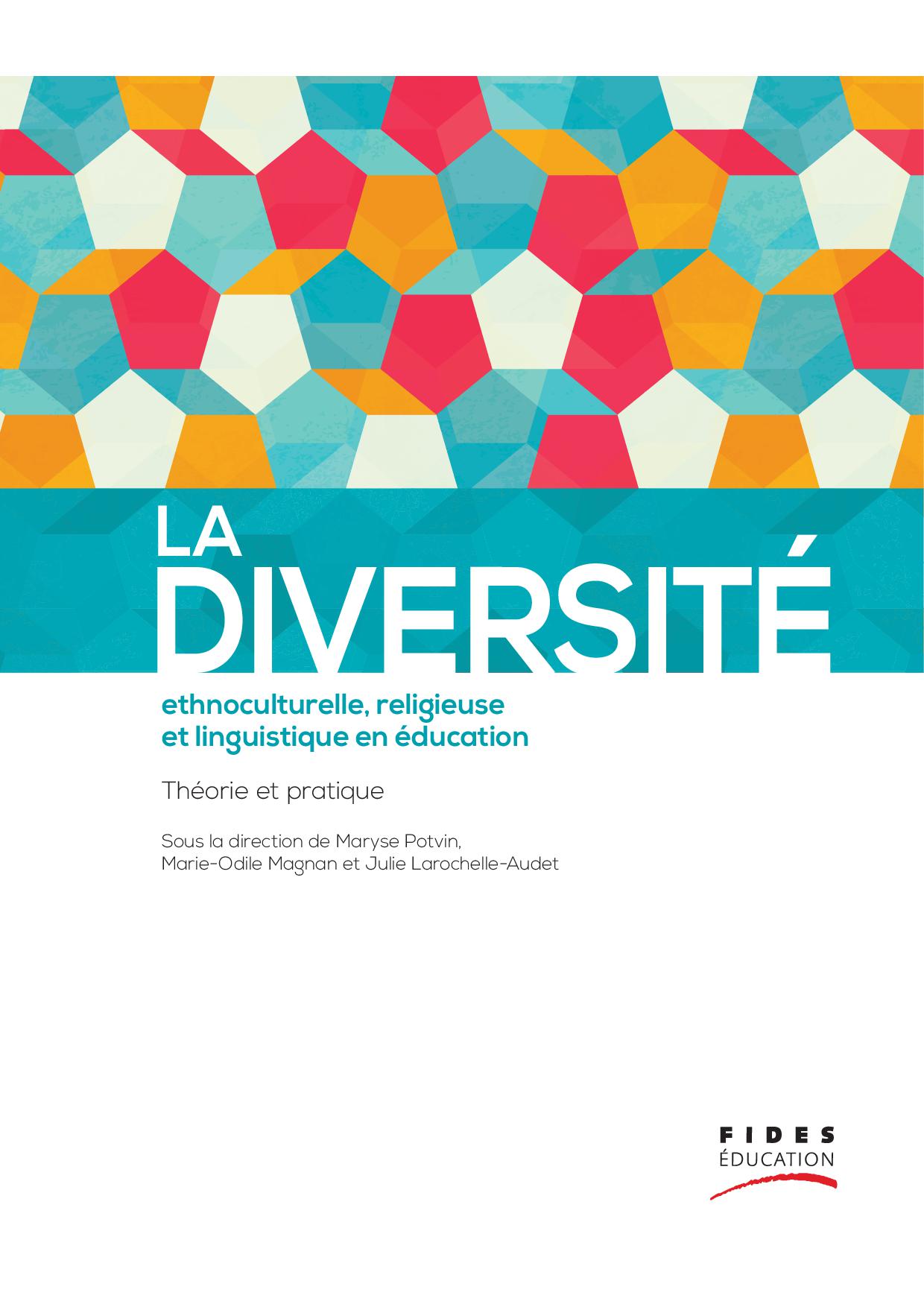
Instruction et socialisation, l’identité personnelle de l’élève immigrant
Beauregard, C., Papazian-Zohrabian, G., & Rousseau, C (2018)
F. Kanouté & J. Charette (Dirs.), La diversité ethnoculturelle dans le contexte scolaire québécois: Pratiquer le vivre-ensemble
Montréal : Presses de l’Université de Montréal | pp. 25-42
VOIR LA PUBLICATION >