
Racisme anti-Noir, profilage racial et système de protection de la jeunesse au Québec
Boatswain-Kyte, A., Hélie, S., & Royer, M. N. (2023, novembre)
Nouvelles pratiques sociales
Vol. 33 /Num. 2 | 21 p.
VOIR LA PUBLICATION >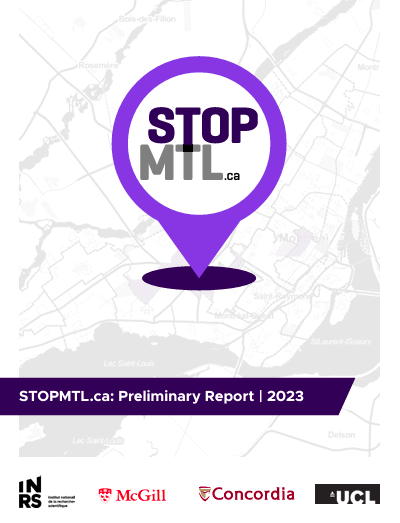
STOPMTL. ca: Preliminary report, 2023
Côté-Lussier, C., Bradford, B., Carmichael, J., Cloutier, M. S., Kakinami, L., Kapo, L. T., & Lashley, M. (2023)
Montréal | 28 p.
VOIR LA PUBLICATION >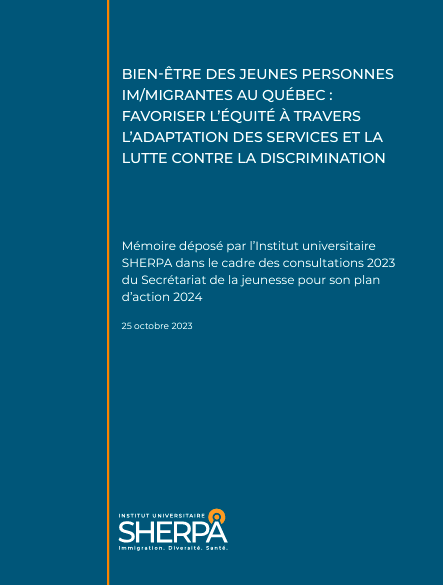
Bien-être des jeunes personnes im/migrantes au Québec : favoriser l’équité à travers l’adaptation des services et la lutte contre la discrimination : mémoire déposé par l’Institut universitaire SHERPA dans le cadre des consultations 2023 du Secrétariat de la jeunesse pour son plan d’action 2024
Fernandes, V., Rudaz, P., Pontbriand, A., & Bentayeb, N. (2023, octobre)
Institut universitaire SHERPA | 33 p.
VOIR LA PUBLICATION >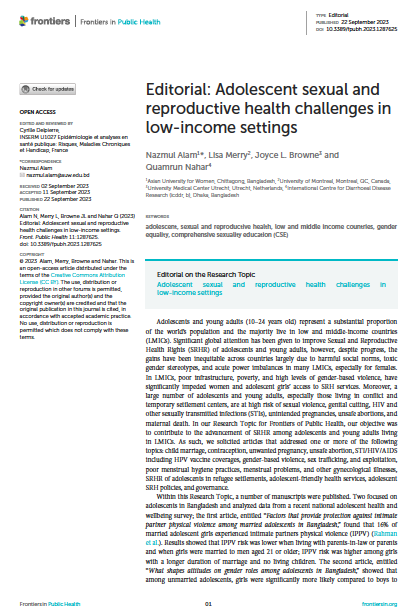
Editorial: Adolescent sexual and reproductive health challenges in low-income settings
Alam, N., Merry, L., Browne, J., & Nahar, Q. (2023, septembre)
Front. Public Health Life-Course Epidemiology and Social Inequalities in Health
Volume 11 - 2023 | 2 p.
VOIR LA PUBLICATION >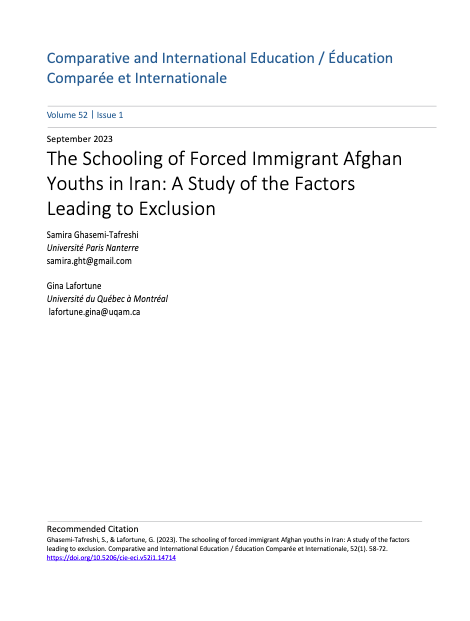
The Schooling of Forced Immigrant Afghan Youths in Iran: A Study of the Factors Leading to Exclusion
Ghasemi-Tafreshi, S., & Lafortune, G. (2023, septembre)
Comparative and International Education / Éducation Comparée et Internationale
Vol. 52/ num. 01 | 16 p.
VOIR LA PUBLICATION >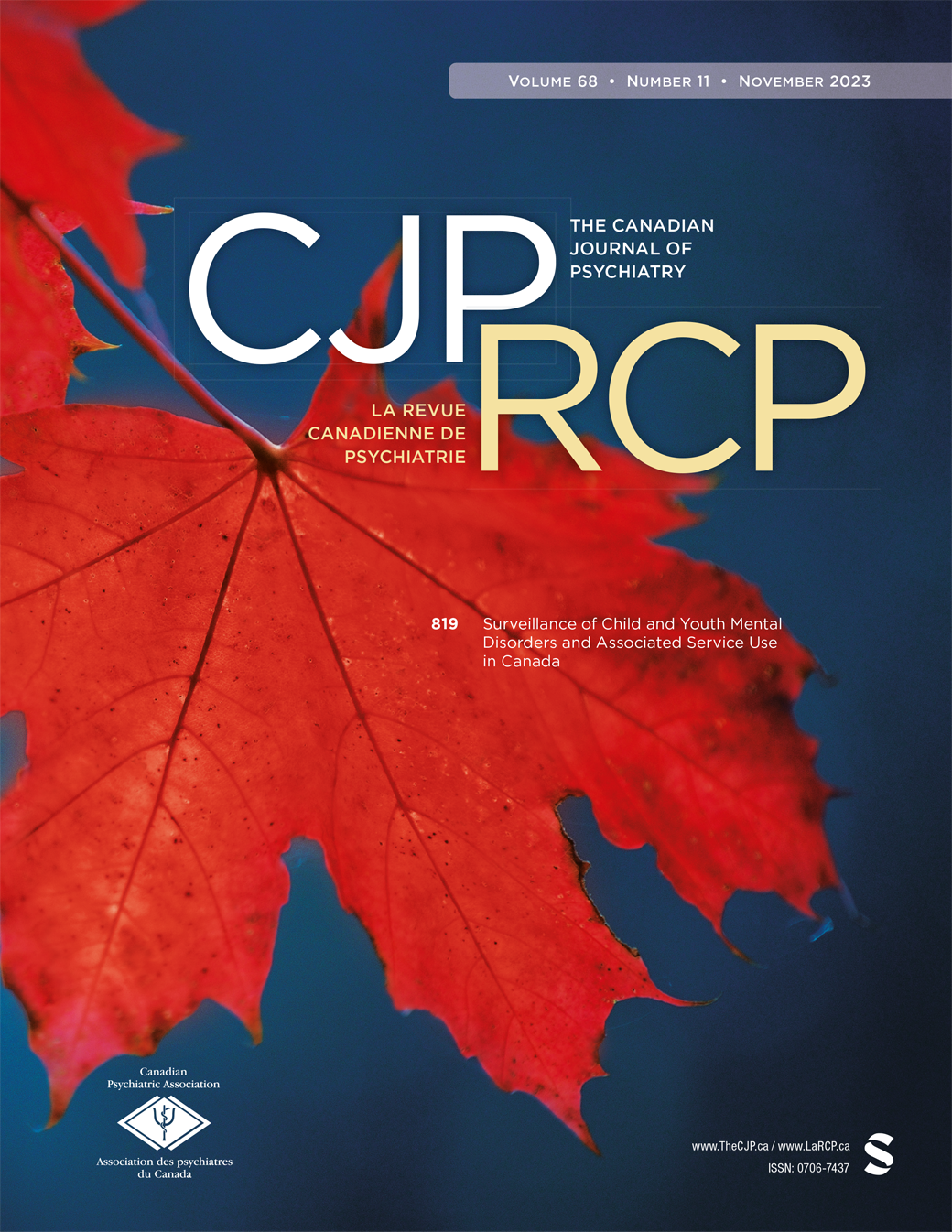
The Burden of Psychosis in Black Communities in Canada: More than a Feeling, a Black Family Experience. T
Cénat, J. M., Lashley, M., Jarvis, G. E., Williams, M. T., Bernheim, E., Derivois, D., & Rousseau, C. (2023, aout)
The Canadian Journal of Psychiatry/ La Revue Canadienne de Psychiatrie
3 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Are we training our students to be white saviours in global health?
Banerjee, A. T., Bandara, S., Senga, J., González-Domínguez, N., & Pai, M. (2023, aout)
The Lancet
Vol. 402/Num. 10401 | 2 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Adolescents Exposed to Cumulative Natural Disasters: A Comparison Between their Realities in Rural and Urban Areas
Pouliot, E., Maltais, D., Gervais, C., Tardif-Grenier, K., Simard, A. S., Gauthier, P., ... & Hamel, A. (2023, juillet)
Prehospital and Disaster Medicine
Vol. 38/ Sup. S1
VOIR LA PUBLICATION >
Embedding anti-racism in Schools of Public Health: a pathway to accountability for progress towards equity
Banerjee, A. T., Tan, A., Boston-Fisher, N., Dubois, C. A., LaFontaine, A., Cloos, P., ... & Evans, T. (2023, juillet)
Canadian Journal of Public Health
volume 114 | 5 p.
VOIR LA PUBLICATION >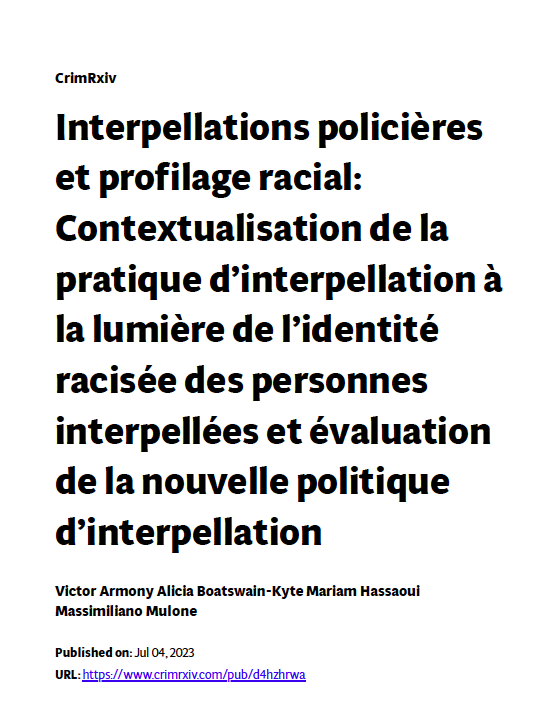
Interpellations policières et profilage racial: Contextualisation de la pratique d’interpellation à la lumière de l’identité racisée des personnes interpellées et évaluation de la nouvelle politique d’interpellation
Armony, V., Boatswain-Kyte, A., Hassaoui, M., & Mulone, M. (2023, juillet)
CrimRxiv The global open access hub for criminology
191 p.
VOIR LA PUBLICATION >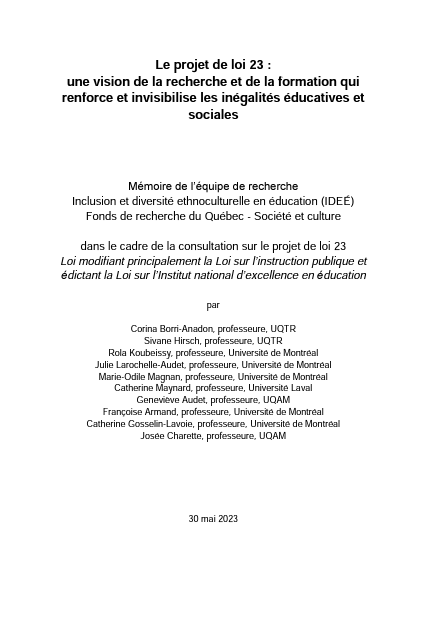
Le projet de loi 23: une vision de la recherche et de la formation qui renforce et invisibilise les inégalités éducatives et sociales
Borri-Anadon, C., Hirsch, S., Koubeissy, R., Larochelle-Audet, J., Magnan, M. O., Maynard, C., Audet, G. & Charette, J. (2023, mai)
Fonds de recherche du Québec - Société et culture | 18 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Taking Action on Racism and Structural Violence in Psychiatric Training and Clinical Practice
Jarvis G.E., Andermann L., Ayonrinde O.A., Beder, M., Cénat, J. M., Ben-Cheikh, I., Fung, K., Gajaria, A., Gómez-Carrillo,A., Guzder, J., Hanafi, S., Kassam, A., Kronick, R., Lashley, M., Lewis-Fernández, R., McMahon, A., Measham, T., Nadeau, L., Rousseau,C., Sadek,J., Schouler-Ocak, M., Wieman, C., Kirmayer, L. (2023, mai)
The Canadian Journal of Psychiatry
VOIR LA PUBLICATION >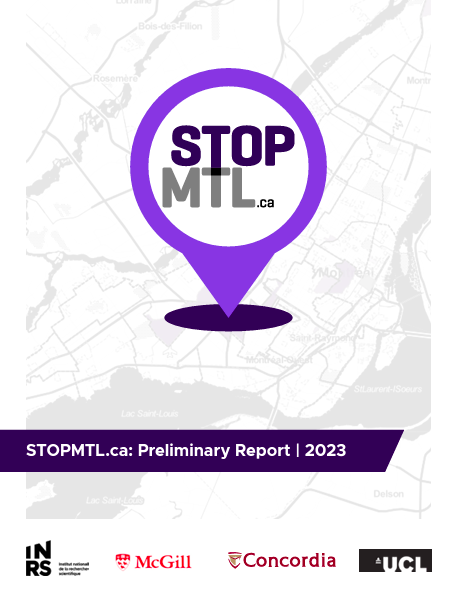
STOPMTL.ca: Preliminary report, 2023
Côté-Lussier, C., Bradford, B., Carmichael, J., Cloutier, M.-S., Kakimani, L., Kapo, L. T., & Lashley, M. (2023, mai)
Centre Urbanisation Culture Société | 28 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Have public health responses to COVID-19 considered social inequalities in health? Insights from Brazil, Canada, France & Mali
Gagnon-Dufresne, M.-C., Gautier, L., Beaujoin, C., Richard, Z., Boivin, P., Medeiros, S. G. de, Ridde, V., & Zinszer, K. (2023, mai)
17th World Congress on Public Health : Rome, Italy
Vol. 5/ Special Issue Supplement | 590 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Sexual Regulation and Liberation in Quebec: Gender Relationships as a Driving Force for Social Change.
Mossière, G. (2023, avril)
Presses de l'Université Laval
20 p.
VOIR LA PUBLICATION >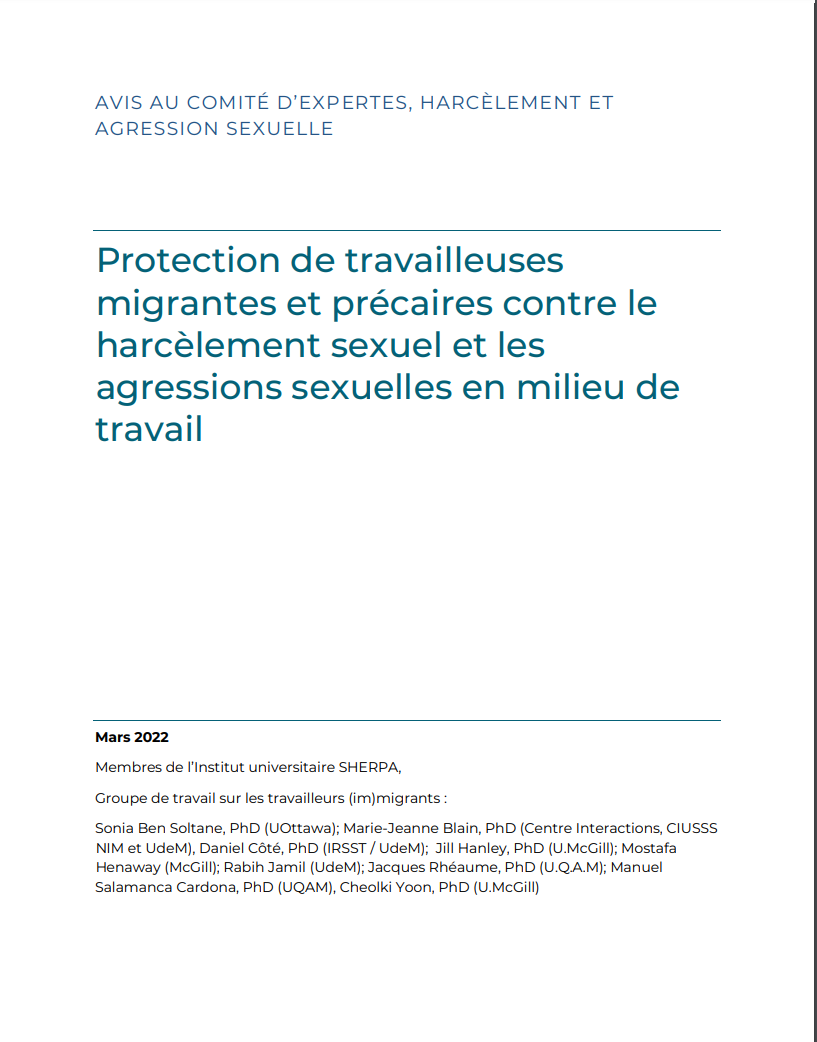
Protection de travailleuses migrantes et précaires contre le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles en milieu de travail AVIS AU COMITÉ D’EXPERTES, HARCÈLEMENT ET AGRESSION SEXUELLE
Groupe de travail sur les travailleurs (im)migrants : Sonia Ben Soltane, Marie-Jeanne Blain, Daniel Côté, Jill Hanley, Mostafa Henaway, Rabih Jamil, Jacques Rhéaume, Manuel Salamanca Cardona, Cheolki Yoon (2023, mars)
Montréal | 19 p.
VOIR LA PUBLICATION >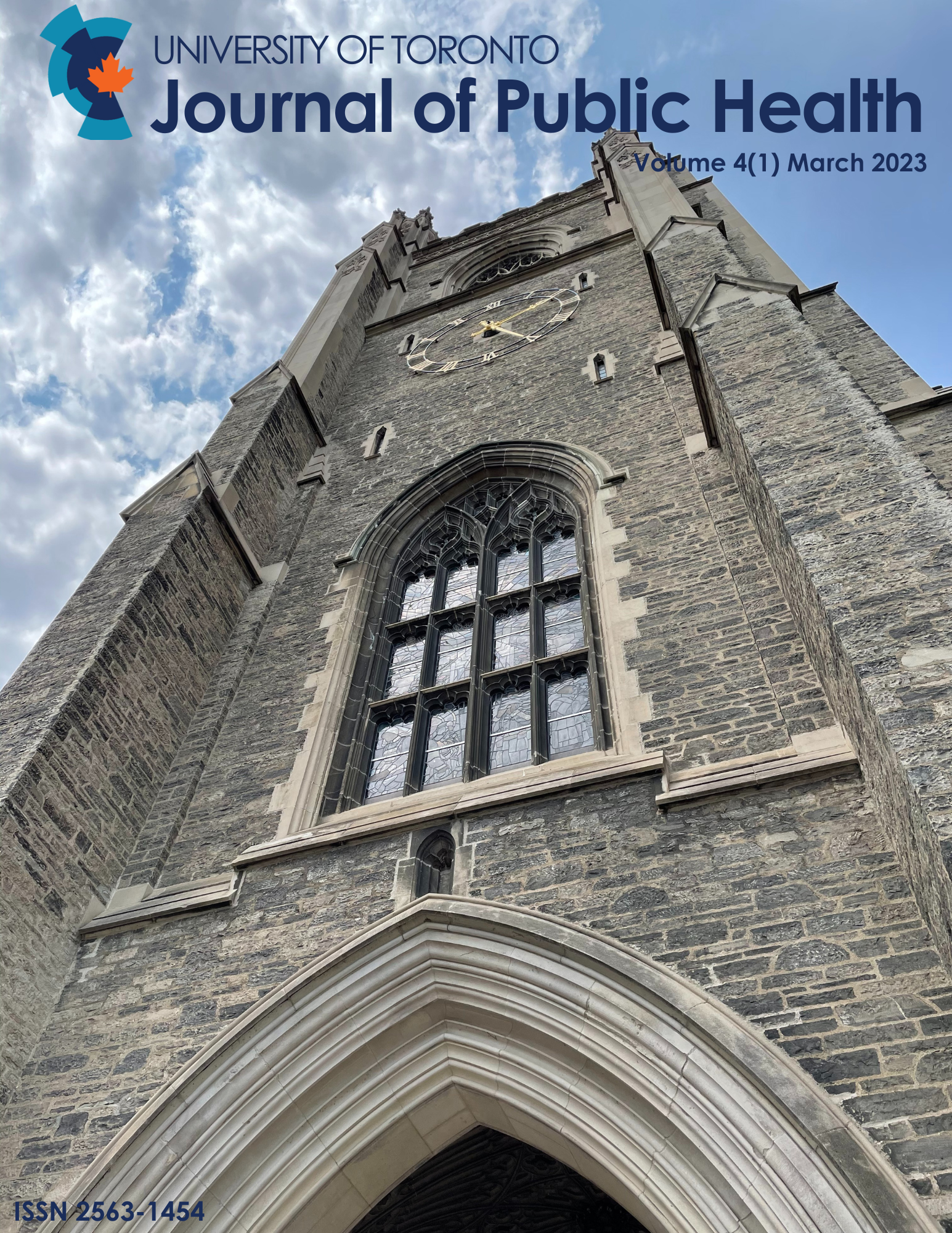
Community-led initiatives bridging the gap to provide linguistically and culturally tailored health and social services in Parc-Extension, Montréal
Senga, J., Moidu, N., Parvez, M., Bui, T., & Banerjee, A. (2023, mars)
University of Toronto, Social and Behavioural Health Sciences
Vol. 4/ No. 1 - Special Issue of Abstracts from Conferences
VOIR LA PUBLICATION >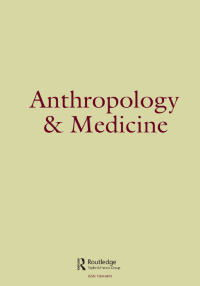
The unsanitary other and racism during the pandemic: analysis of purity discourses on social media in India, France and United States of America during the COVID-19 pandemic
Desmarais, C., Roy, M., Nguyen, M. T., Venkatesh, V., & Rousseau, C. (2023, mars)
Anthropology & Medicine
Vol. 30/ Num. 1 | 16 p.
VOIR LA PUBLICATION >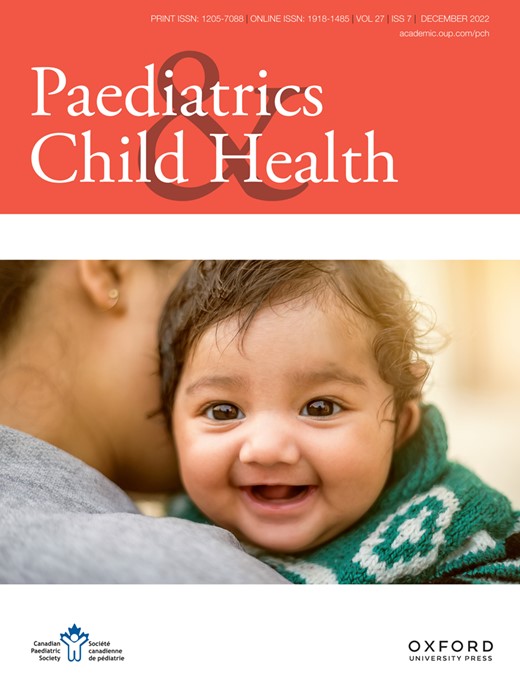
Pandemic checkups: Mobile paediatric care and vaccination in disadvantaged areas
Xuan-Lan Nguyen, Anne, Patricia Li, and Rislaine Benkelfat (2022, décembre)
Paediatrics & Child Health
Vol. 27/ Issue 7 | 2 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Forced to uphold white supremacy, until we couldn’t anymore
Banerjee, A., Tan, A. (2022, novembre)
PERSPECTIVES|THE ART OF MEDICINE| The Lancet
VOL. 400/ Num. 10366 | 2 p.
VOIR LA PUBLICATION >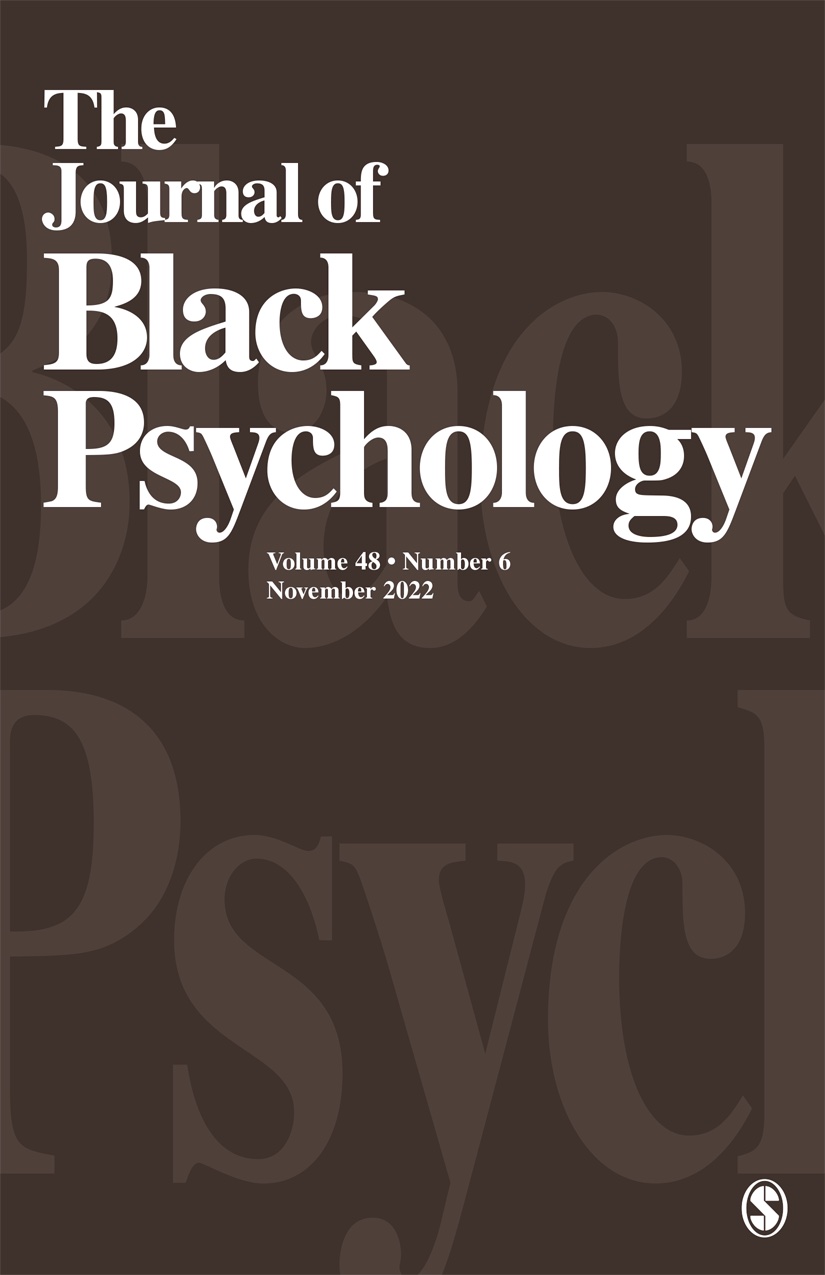
‘It Just Feels Like an Invasion’: Black First-Episode Psychosis Patients’ Experiences With Coercive Intervention and Its Influence on Help-Seeking Behaviours
Knight, S., Jarvis, G. E., Ryder, A. G., Lashley, M., & Rousseau, C. (2022, novembre)
Journal of Black Psychology
Vol.48 / Issue 6 | 37 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Vaccination des enfants dans les quartiers marginalisés : défis liés à l’équité et à la diversité dans le cadre des campagnes de vaccination contre la COVID-19
Rousseau, C., Quach, C., Dubé, V., Vanier-Clément, A., Santavicca, T., & Monnais-Rousselots, L. (2022, octobre)
Relevé des maladies transmissibles au Canada
Vol. 48/ issue 10 | 3 p.
VOIR LA PUBLICATION >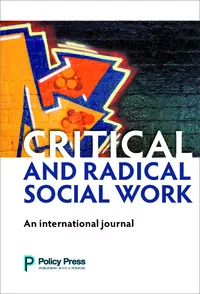
‘We want our own data!’: building Black community accountability in the collection of health data using a Black emancipatory action research approach
Boatswain-Kyte, A., Brotman, S. , Callender, T., Dejean, B., Hanley, J., Jivraj, N., Lindor, T., Moran, J.,Muir, S., and Puspparajah, D. (2022, juin)
Publisher: Policy Press
Vol.10/ Num. 2 | 21 p.
VOIR LA PUBLICATION >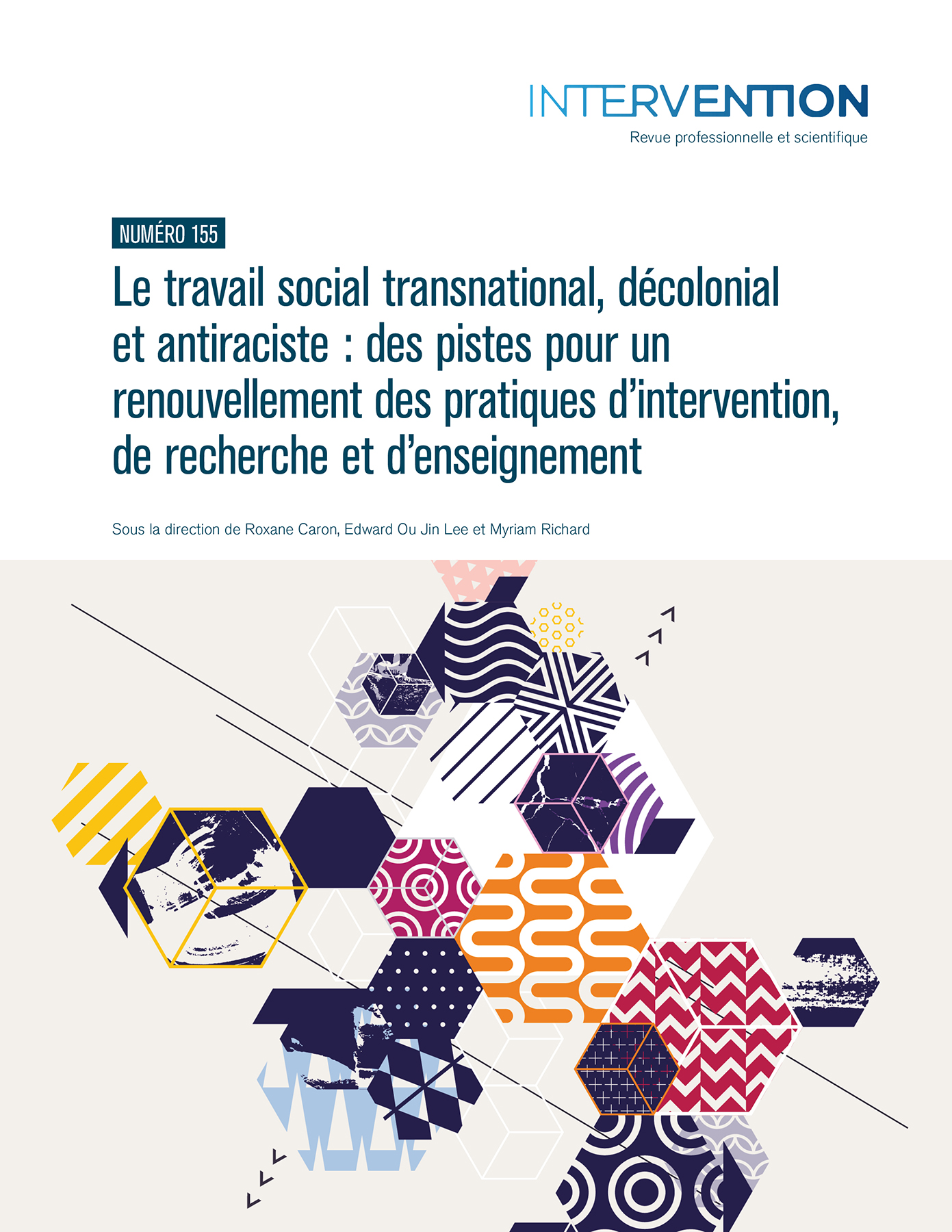
Racisme et femmes descendantes de migrants asiatiques : décoloniser les savoirs sur l’interculturalité en travail social au Québec
Hamisultane, Sophie, Edward Ou Jin Lee, Josiane Le Gall, André Ho, Charlène Lusikila (2022, juin)
Revue Intervention
Numéro 155 / OTSTCFQ | 15 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Des postures affectées dans la recherche et l’intervention auprès des personnes faisant l’objet de racisme : quelques réflexions sur l’engagement et le fait d’être concerné.e personnellement
Hamisultane, Sophie, Edward Ou Jin Lee, Josiane Le Gall, André Ho, and Charlène Lusikila (2022, avril)
Revue Intervention
Numéro 154 | 12 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Anti-racist education in social work: an exploration of required undergraduate social work courses in Quebec
Shah, K.; Boatswain-Kyte, A. and E.O.J. Lee (2022, février)
Canadian Social Work Review / Revue canadienne de service social
Vol. 38, number 2 : Erudit | 16 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Confronting whiteness in social work education through racialized student activism
Mbakogu, I.; Duhaney, P.; Ferrer, I. and E.O. J. Lee (2022, février)
Canadian Social Work Review / Revue canadienne de service social
Vol. 38, number 2 | 27 p.
VOIR LA PUBLICATION >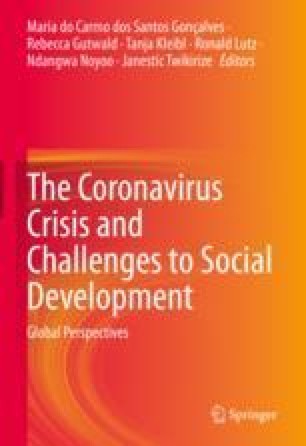
COVID-19, Hyper Vulnerabilities, Silenced Traumas, and Colonial Scars: Social Work Scholars Engaging in Critical Dialogue with Racialized Communities
Hamisultane, S., Lee, E. O. J. et R. Caron (2022)
The Coronavirus Crisis and Challenges to Social Development (Gonçalves M..C..S., Gutwald R., Kleibl T., Lutz R., Noyoo N., Twikirize J. (dirs.))
Springer, Cham | pp 237-249
VOIR LA PUBLICATION >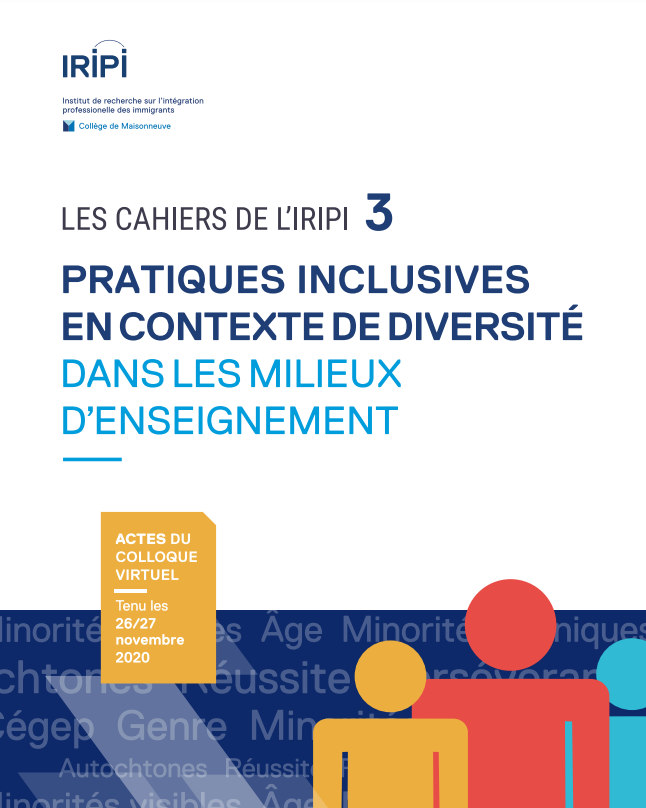
De l’inclusion et de la réussite au collégial : « Au fond, vous voulez savoir ce que ça veut dire être noir.e au cégep? »
Lafortune, G. (2021)
Montréal : IRIPI | p.8-15
VOIR LA PUBLICATION >
Editorial commentary: public mental health and racism in Europe
Cloos, P. et J. Bilsen (2021)
Archives of Public Health
79(200) | 2 p.
VOIR LA PUBLICATION >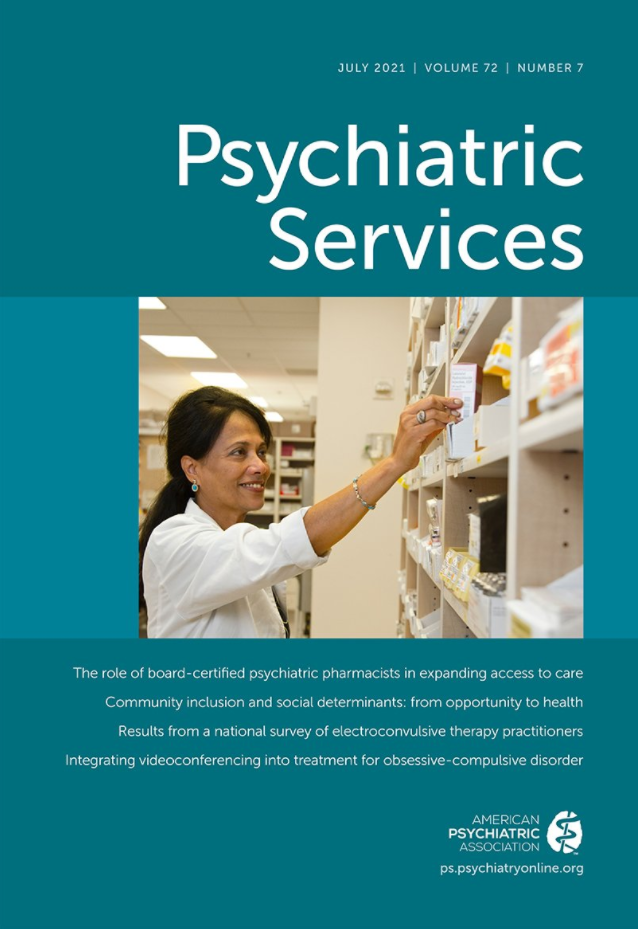
Ethnoracial Differences in Coercive Referral and Intervention Among Patients With First-Episode Psychosis
Knight, Sommer, Jarvis, G. Eric , Ryder, Andrew G., Lashley, Myrna, Rousseau, Cécile (2021)
Psychiatric Services
VOIR LA PUBLICATION >
Dissecting systemic racism: policies, practices and epistemologies creating racialized systems of care for Indigenous peoples
Fraser, S.L., Gaulin, D. & Fraser, W.D. (2021)
Int J Equity Health
20 | 164
VOIR LA PUBLICATION >
Historical Scientific Racism and Psychiatric Publications: A Necessary International Anti-racist Code of Ethics
Imen Ben-Cheikh, Roberto Beneduce, Jaswant Guzder, Sushrut Jadhav, Azaad Kassam, Myrna Lashley, Malika Mansouri, Marie Rose Moro et Don Quang Tran (2021)
The Canadian Journal of Psychiatry
p. 1-10.
VOIR LA PUBLICATION >
A Latent Class Analysis of Attitudes Towards Asylum Seeker Access to Health Care
Frounfelker, R.L., Rahman, S., Cleveland, J. et Rousseau, C. (2021, avril)
J Immigrant Minority Health
VOIR LA PUBLICATION >
Personnes descendantes de migrants racisées face aux micro-agressions : silence, résistance et communauté imaginaire d’appartenance
Hamisultane, S. (2021, avril)
Nouvelles pratiques sociales
31(2) | 163–181
VOIR LA PUBLICATION >
The importance of hair in the identity of Black people
Lashley, M. (2021, avril)
Nouvelles pratiques sociales
31(2) | 206–227
VOIR LA PUBLICATION >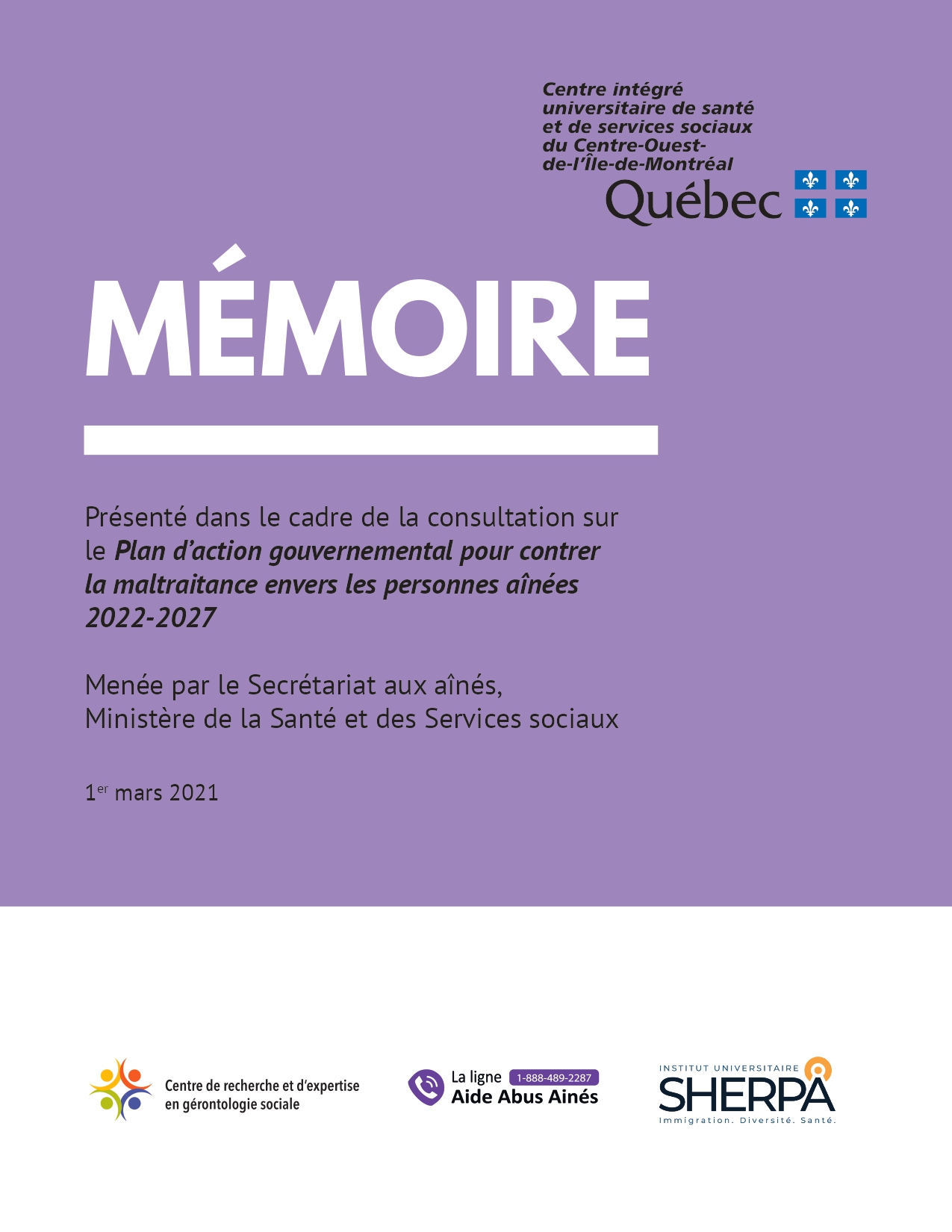
Mémoire Présenté dans le cadre de la consultation sur le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027
Couture. M; Aubin, G.; Beauchamp, J.; Beaulieu, M.; Bédard, M-E.; Brotman, S.; Drolet, MJ; Hanley, J.; Hebblethwaite, S.; Lafontaine, C.; Lecompte, M; Lord, MM; Montpetit C.; Sawchuk, K.; Smele, S.; Soulières, M.; Wallach, I. (2021)
Montréal : CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
VOIR LA PUBLICATION >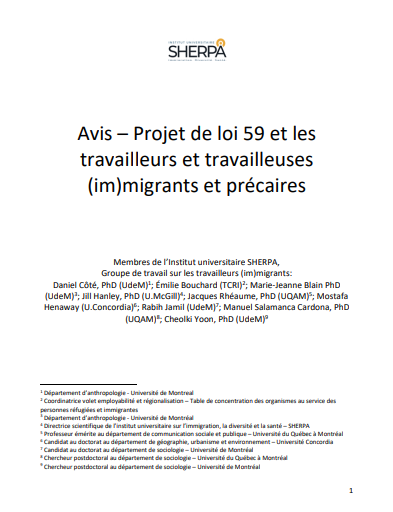
Avis – Projet de loi 59 et les travailleurs et travailleuses (im)migrants et précaires
Côté, D. Bouchard, É., Blain, MJ, Hanley, J., Rhéaume, J., Henaway, M., Jamil, R., Cardona M. S., Yoon, C. (2021, mars)
En ligne mars 2021 | 16 pp.
VOIR LA PUBLICATION >
Édito – L’éducation inclusive en contexte de diversité ethnoculturelle : comprendre les processus d’exclusion pour agir sur le terrain de l’école
Magnan, MO, Gosselin-Gagné, J., Audet, G. and Conus, X. (2021, mars)
Recherches en éducation
44
VOIR LA PUBLICATION >
Socio-cultural correlates of self-reported experiences of discrimination related to COVID-19 in a culturally diverse sample of Canadian adults
Miconi, D., Li, Z., Frounfelker, R., Venkatesh, V., Rousseau, C (2021, mars)
International Journal of Intercultural Relations
81 | 176-192
VOIR LA PUBLICATION >
Télésanté en contexte de pandémie et de déconfinement : Pratiques infirmières innovantes et partenariats pour des communautés équitables, sécuritaires et durables
Lapierre, J., Croteau, S., Gagnon, M.-P., Caillouette, J., Robichaud, F., Bouchard, S., Côté, J. Aboulhouda, I., Ménard, K., Picard, S., Myette, È.-M., Drapeau, V., Vissandjee, B., & Kankindi, B., Doré, C. (2021, février)
Global Health Promotion
En ligne 18 février 2021
VOIR LA PUBLICATION >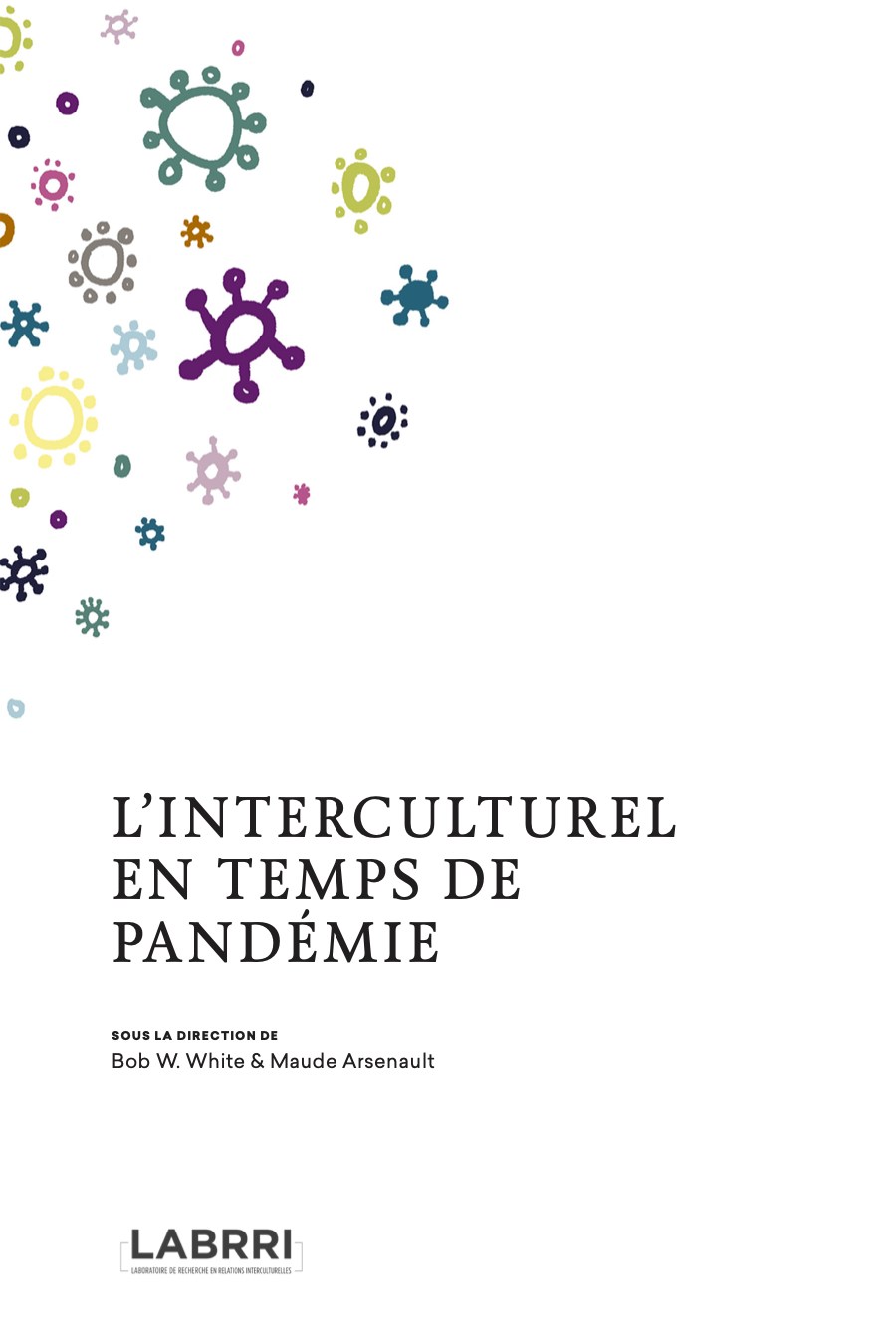
Précarité du travail et inégalités sociales de santé: quelles leçons à tirer de la pandémie de COVID-19
Côté, D., Dubé, J., Frozzini, J. (2021)
L’interculturel en temps de pandémie
Montréal: LABRRI, Université de Montréal | 74
VOIR LA PUBLICATION >
Paradoxe entre idéal démocratique et autocensure des personnes racisées en milieu de travail : l’expérience d’une clinique de l’interculturalité
Hamisultane, S. (2020, décembre)
Communiquer
(3)
VOIR LA PUBLICATION >
Beyond White Ignorance and Towards Black Survival
Lashley, M. (2020, décembre)
Intervention Symposium – “Black Humanity: Bearing Witness to COVID-19” Organized by Elaine Coburn and Wesley Crichlow
VOIR LA PUBLICATION >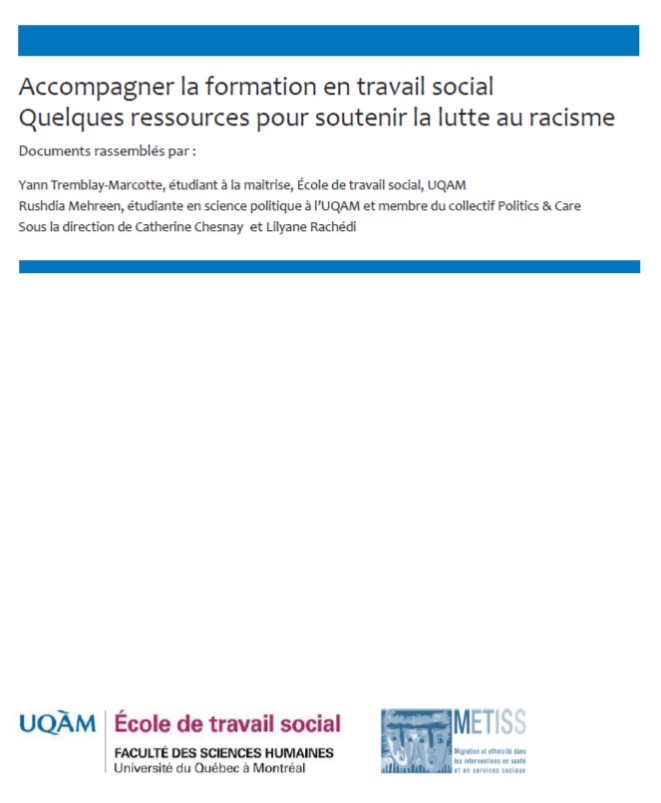
Accompagner la formation en travail social. Quelques ressources pour soutenir la lutte au racisme
Tremblay-Marcotte, Y., Mehreen, R., Chesnay, C. et L. Rachédi (2020)
Montréal : École de travail social, UQAM | 281 p.
VOIR LA PUBLICATION >
Les Femmes anishinaabeg (Canada), la santé et l’eau : des savoirs traditionnels aux mobilisations contemporaines
Castelli T., Thinel M., Cantin A-A., and Cloos, P. (2020, novembre)
Amnis
19
VOIR LA PUBLICATION >
Pandémie et communautés minoritaires marginalisées : vers une approche inclusive en santé publique?
Rousseau, C., Jaimes, A. & El-Majzoub, S. (2020)
Canadian Journal of Public Health
online
VOIR LA PUBLICATION >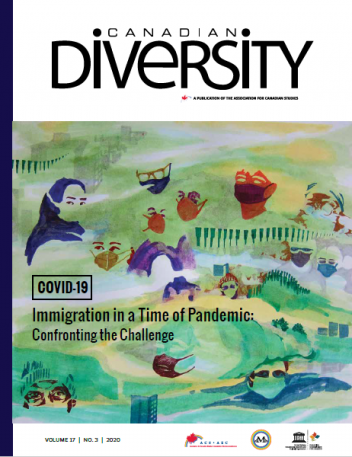
Préoccupations, intersectionnalité et violence domestique en contexte de COVID-19
Hyman, H. et B. Vissandjée (2020)
Diversité canadienne
17(3) | pp.39-45
VOIR LA PUBLICATION >
Vivere insieme in contesti di polarizzazione sociale: fattori di rischio e di protezione in un campione di giovani studenti canadesi / Vivre ensemble dans des contextes de polarisation sociale: facteurs de risque et de protection chez un échantillon de jeunes étudiants canadiens
Miconi, D., Rousseau, C. (2020)
Educationla Reflexive Practice
1 | pp. 55-73
VOIR LA PUBLICATION >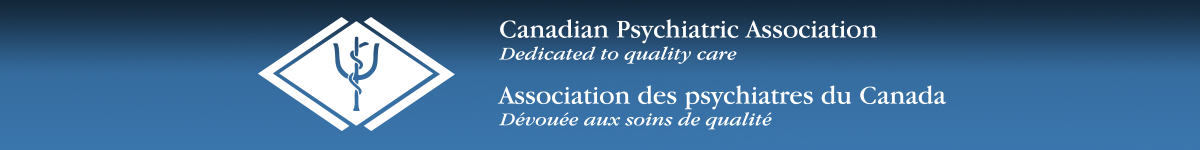
Un appel à l’action en matière de racisme et de justice sociale en santé mentale
Laurence J. Kirmayer, Suman Fernando, Jaswant Guzder, Myrna Lashley, Cécile Rousseau, Meryam Schouler-Ocak, Roberto Lewis-Fernández, Kenneth Fung, G. Eric Jarvis (2020)
Association des psychiatres du Canada
VOIR LA PUBLICATION >